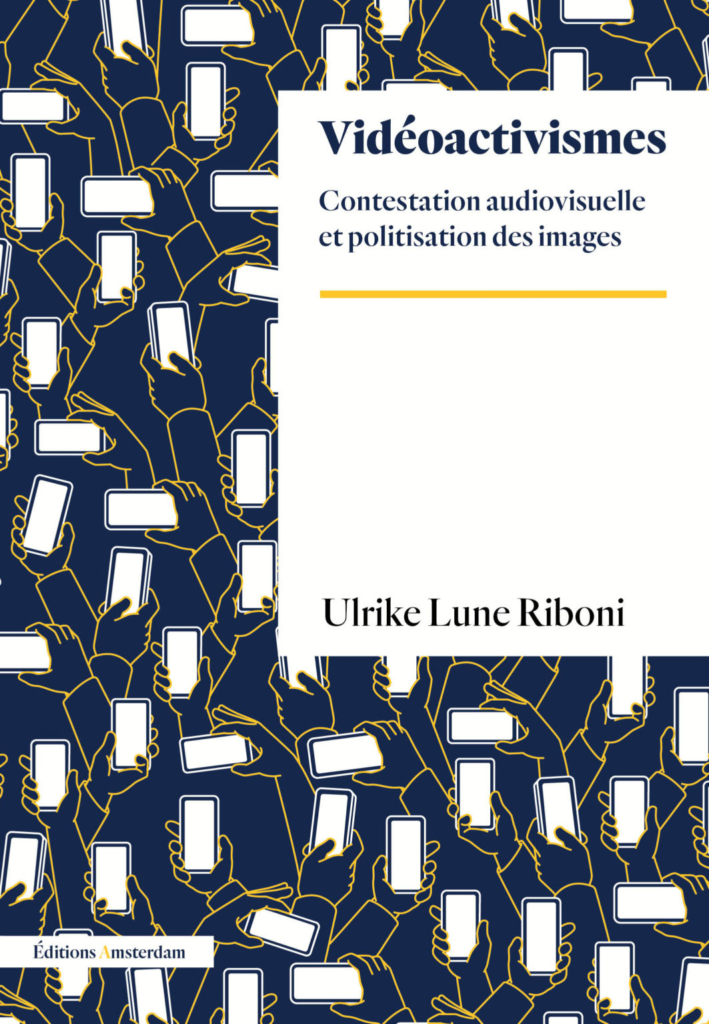« Ce n’est pas pour rien que les forces de l’ordre parlent de guerre des images »
Omniprésentes, spectaculaires, autoproduites et autodiffusées, les images des mouvements sociaux s’inscrivent dans un nouveau régime médiatique qu’analyse Ulrike Lune Riboni, chercheuse en sciences de la communication, autrice de Vidéoactivismes, qui en pointe aussi les risques.
dans l’hebdo N° 1779 Acheter ce numéro

© Maxime Sirvins
Vidéoactivismes, Ulrike Lune, Riboni Amsterdam, 208 pages, 18 euros.
Ulrike Lune Riboni est maîtresse de conférences en sciences de la communication à l’université Paris-8, et autrice de Vidéoactivismes (éd. Amsterdam, 2023). Ses recherches portent sur la médiatisation des mouvements sociaux, notamment par celles et ceux qui luttent.
Votre essai effectue un long retour historique sur ce que vous appelez les « vidéoactivismes », et montre qu’un changement s’est produit au cours des dix dernières années, notamment en France. Est-il seulement dû à l’émergence des réseaux sociaux ?
Certains moments internationaux font tournant, comme 2005 avec les attentats de Londres ou 2011 avec la Tunisie. On ne peut pas penser la médiatisation en dehors d’un espace globalisé. Il y a une transformation majeure, qui est due, déjà, à des évolutions techniques évidentes. Nous avons toutes et tous une caméra dans la poche, ce qui était impensable avant. Les jeunes générations n’arrivent pas à mesurer que chaque image avait un coût de développement, de pellicule. Cela transforme fondamentalement le rapport aux images, et pas simplement à la médiatisation. Avec les réseaux sociaux, non seulement on produit, on « prend des images » mais, surtout, on peut les partager. Pour qualifier tout cela, on peut employer le terme d’auto-médiatisation, et dire qu’avec les révoltes après la mort de Nahel, par exemple, les jeunes ont pu auto-médiatiser ce qui se passait. De fait, on pouvait suivre les émeutes sur les réseaux par des biais qui ne sont pas du tout traditionnels.
Les procédures judiciaires de répression de mouvements comme les révoltes après la mort de Nahel ou encore les gilets jaunes ont massivement recouru à des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Les personnes qui se filment ont-elles conscience de ces risques ?
Non, on sent clairement cette absence de conscience des risques. Parfois, la vidéo va aider une personne, comme ça a été le cas pour une femme à Marseille accusée par un policier de l’avoir frappé, et poursuivie pour violences : les images ont prouvé que c’était le contraire, et son inculpation a été requalifiée en rébellion. Là, évidemment, la vidéo va permettre de contredire la version policière, qui, on le sait, pèse plus que la parole des inculpés. Mais la vidéo présente deux types de risques, liés à la prise puis à la diffusion des images. La conscience de ces risques est très faible, car on parle de personnes très jeunes, qui font un usage peu réfléchi de réseaux sociaux faisant partie de leur quotidien.
De surcroît, on constate une extension inédite des possibilités de mise en cause sur la base des images. Autour de la réforme des retraites et du 49.3, des arrestations massives ont été effectuées. Des policiers ont pu dire aux personnes gardées à vue : « Si, dans votre téléphone, il y a des images de choses qui brûlent, on considérera que vous avez souhaité filmer, et que c’est le signe que vous auriez pu participer à allumer le feu. » On établit une suspicion de commission de l’acte simplement parce qu’on en a une trace. Sauf qu’avec le changement de notre rapport à l’image, ce geste de la documentation quotidienne, individuelle fait partie de notre vie. D’un coup, il y a des images qu’on ne devrait pas prendre parce qu’elles pourraient être suspectes.
Ensuite, il y a la question des réseaux sociaux. Avec la diffusion, on passe à une sorte d’étape supérieure : on va être inculpé pour « incitation à l’émeute » ou « incitation à l’attroupement en vue de commettre des violences ». Ces chefs d’accusation conduisent à mettre en examen des jeunes qui, à un moment donné, sont en train de faire les malins parce que ce sont des adolescents, et qui finissent devant le système pénal pour cela. Quelque chose de très grave se joue là.
Autour des mouvements sociaux, il y a un écosystème de photographes indépendants qui ont un rapport esthétique à leurs images, mais aussi très politique, et font très attention aux codes militants, comme l’anonymisation de leurs sujets…
Là aussi, on peut distinguer plusieurs catégories. Gaspard Glanz, de Taranis News, par exemple, vient d’un espace social très clair, la gauche radicale, tout en ayant construit un discours affirmant qu’il est un journaliste et revendiquant une certaine neutralité. En même temps, ses choix et son intérêt pour certaines images et contenus sont très clairs. Au-delà de la relation aux médias traditionnels, la question des journalistes qui font des live pendant les manifestations, notamment des « manifs sauvages », non déclarées, se pose aussi. La police suit ces diffusions.
En parallèle existe une génération de photographes qui s’investissent dans les mobilisations, et chez laquelle il y a beaucoup de travail esthétique, parfois de grande qualité par ailleurs, et une grande conscience des enjeux d’anonymisation. Et puis il y a toute cette part de gens qui s’improvisent photographes, ces fameux « quidams » qui photographient. Eux-mêmes cherchent l’image esthétique, vont s’arrêter devant le panneau publicitaire en feu, et ont une conscience immédiate de ce que cela crée politiquement. Tous n’ont cependant pas conscience de l’anonymisation.
Il faut s’interroger sur l’esthétisation du mouvement social.
Il faut s’interroger sur cette esthétisation du mouvement social. Toute cette production iconographique très forte, qui construit un imaginaire, s’adresse à une jeunesse déjà très politisée, à la gauche de la gauche. Il s’agit là d’un imaginaire que l’État tente de combattre. La législation française est hors du commun par rapport à d’autres pays européens. Elle a tenté d’empêcher la circulation des images avec l’article 24 de la loi « sécurité globale ». Ce n’est pas pour rien que certains acteurs des forces de l’ordre parlent de guerre des images.
Peut-on diagnostiquer une forme de désensibilisation, à une époque où ces images de violences ne sont plus exceptionnelles, où on est presque noyé sous les images ultraviolentes ?
La question de la sensibilité, en particulier chez les jeunes, est un thème éternel. On dit tout le temps que les jeunes apprécient des jeux vidéo ou des films ultraviolents. Effectivement, quand on se trouvait dans un écosystème médiatique dans lequel on voyait une image par mois dans le journal, celle de la petite fille brûlée au napalm pendant la guerre du Vietnam représentait un coup de poing en plein visage. Pour les vidéoactivistes des années 1960 à 1980, faire et voir un film, c’était un événement. Aujourd’hui, l’écosystème est complètement différent. Pour autant, la vidéo de la mort de George Floyd reste insupportable, atroce.
Quand des vidéos de violences policières circulent, beaucoup de jeunes ne les regardent pas, ou à peine, et ils en sont en tout cas horrifiés. Il n’y a pas de désensibilisation. Ce qui est terrible, en revanche, c’est cette banalisation de la violence policière, cette normalisation. Je suis enseignante et, depuis quelque temps, mes étudiants, même les plus politisés, ne vont plus en manifestation, car ils ont peur. Ils ont conscience qu’une manifestation est devenue un événement dans lequel on investit son corps, et dans lequel on se met en danger.
Est-il toujours utile de filmer la police ?
C’est utile dans certaines situations, mais dans un certain nombre d’autres, on ne pourra rien faire de la vidéo. Pour autant, oui, il vaut mieux filmer, ne serait-ce parce que les quelques travaux menés sur la réception policière montrent qu’être filmé provoque au moins un effet de censure potentiel. Face à une arrestation, sortir son téléphone a du sens. Cela peut au mieux produire un effet de censure, au pire permettre d’avoir une trace de ce qui s’est passé. Mais on en vient à craindre de filmer ou de photographier même des événements sans enjeu, comme des assemblées générales étudiantes. En conséquence, beaucoup de ces mouvements sont de moins en moins documentés.
On en vient à craindre de filmer ou de photographier même des événements sans enjeu.
Comment archiver cette profusion iconographique ? On ne peut pas demander à l’État d’archiver des contenus produits contre lui…
Un collectif avait archivé énormément des vidéos produites pendant le Printemps arabe en Égypte. Lors du mouvement des gilets jaunes, il y a eu le collectif Plein le dos. Des bénévoles, des militants, à un moment donné, consacrent du temps d’engagement à la constitution de la mémoire de la lutte. C’est une forme de militantisme, mais qui nécessite une certaine culture de l’archive et de sa nécessité. Il n’y a, par exemple, quasiment pas d’images publiques de moments comme l’occupation de la fac de Tolbiac en 2018. Peut-être que c’est grave, peut-être que ça ne l’est pas, peut-être disposera-t-on de suffisamment de récits qui permettront de construire l’histoire. Et même quand on a des archives et du contenu produit, reste l’enjeu de la diffusion de ces histoires, de la transmission de ces luttes. Les histoires des luttes antiracistes en France sont très peu transmises.
Les médias traditionnels expriment aussi un certain mépris pour ces auto-médiatisations et leurs auteurs…
Cette documentation esthétique des luttes subit une double peine. D’abord avec une invalidation par le système médiatique des « quidams à la pulsion scopique qui filment n’importe quoi », des jeunes qui filment les émeutes, afin de les mettre en dehors du champ des « vrais professionnels ». Ensuite au travers de la critique intérieure de la gauche radicale, de cette iconophobie résumée par l’expression « Tout photographe est un flic », qui doit dater des années 1968. Dans les milieux autonomes, il ne faut pas filmer, il ne faut pas photographier.
L’iconophobie interne à la gauche radicale va de pair avec une critique de certaines pratiques.
Des fanzines sont parus ces dernières années avec, par exemple, un manuel enjoignant à casser des caméras. Mais c’est limité à une certaine frange de la gauche radicale. Dans les mouvements antiracistes ou LGBT, ce discours n’est presque pas tenu. Ce sont des acteurs qui ont besoin que leurs corps soient photographiés, existent dans l’espace médiatique. Il y a une différence majeure entre ceux qui peuvent se permettre de se cacher le visage et de refuser d’être représentés, et ceux qui se battent pour être représentés. Il y a quelque chose à interroger à cet endroit. Quels sont les acteurs qui refusent à tout prix d’être photographiés, même quand ils ne sont pas en situation de mise en danger effective parce qu’on les photographie ?
Cette iconophobie interne à la gauche radicale va de pair avec une critique de certaines pratiques, dont les affrontements liés à la pratique du black bloc, qui constituerait une spectacularisation contribuant à invisibiliser les arguments et les revendications. Les émeutes anti-G8 de Gênes, en 2001, furent un grand moment militant sur l’utilisation de ces formes d’action, avec des réflexions sur le refus de la spectacularisation : elle ferait le jeu des médias qui s’en repaissent. Cette critique rencontre alors la question de la représentation : est-ce que provoquer des émeutes pour être représenté, ce n’est pas servir la soupe aux médias, qui veulent de l’affrontement en tête de manifestation ou dans les quartiers populaires, pour décrédibiliser les mouvements ? C’est une question qui n’a pas vraiment de réponse pour le moment.
Pour aller plus loin…

Tour de France : Franck Ferrand, commentateur réac’ toujours en selle

La CGT et le Tour de France : quand sport et luttes se marient bien

« Ils parlent d’échange de migrants comme si les personnes étaient des objets »