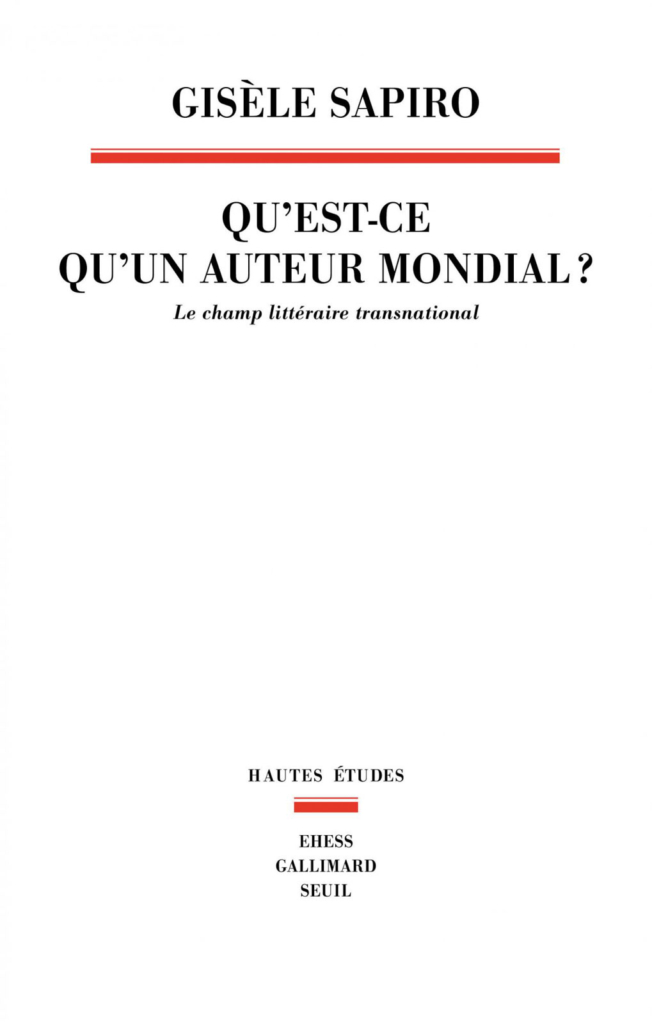Gisèle Sapiro : « Les œuvres ne suffisent pas à fonder la réputation mondiale d’un auteur »
La sociologue de la littérature analyse les rouages de la consécration transnationale des auteurs admis au rang de classiques reconnus. Elle étudie pour cela le rôle des « intermédiaires » comme les éditeurs, traducteurs, préfaciers, prix littéraires…
dans l’hebdo N° 1831 Acheter ce numéro

© Maxime Sirvins
Qu’est-ce qu’un auteur mondial ? Le champ littéraire transnational, Gisèle Sapiro, EHESS/Gallimard/Seuil, coll. « Hautes études », 448 pages, 25 euros.
Née en 1965, Gisèle Sapiro a soutenu son doctorat de sociologie sous la direction de Pierre Bourdieu. Médaille d’argent du CNRS (2021), elle a publié de nombreux ouvrages sur le champ littéraire, la circulation des idées ou la responsabilité politique de l’écrivain, et sur Bourdieu lui-même. Après avoir codirigé Pierre Bourdieu, sociologue (Fayard, 2004), elle a coordonné le Dictionnaire international Bourdieu (CNRS éditions, 2020).
Selon vous, sociologue de la littérature internationale, comment de grands auteurs tels que Montaigne, Voltaire, Proust, Kafka, Mann, Faulkner, Céline ou Sartre sont-ils devenus des « auteurs mondiaux », reconnus comme tels ?
Mon livre met en avant le travail des intermédiaires et des médiateur·ices qui contribuent à fabriquer l’auteur·e mondial·e, c’est-à-dire qui est traduit, réédité, invité ou convoqué partout dans le monde, dont le nom fait référence. Il ne s’agit pas de minorer la qualité des œuvres, mais de dire qu’elle ne suffit pas à fonder la réputation internationale, qu’il y a un travail de construction pris en charge par ces intermédiaires et médiateur·ices. Dans son célèbre article « Qu’est-ce qu’un auteur ? » (1), Foucault montre que l’auteur apparaît d’abord, au XVIIe siècle, avec la responsabilité pénale et le besoin de contrôler l’imprimé, puis avec la propriété littéraire au XVIIIe siècle.
Dans Dits et Écrits, tome 1, 1954-1988, Gallimard, 1994 [1969], p. 789-820.
Cette appropriation s’est internationalisée à la fin du XIXe siècle avec la Convention de Berne, qui régule les échanges internationaux. On attribue aux noms des auteurs que vous citez non seulement leurs textes en langue originale, mais aussi toutes les traductions. Les traducteur·ices ne sont reconnu·es comme auteur·es que depuis peu, mais restent au deuxième rang.
Pierre Bourdieu demandait « Qui crée les créateurs ? » et c’est aussi cette question qui guide mon approche, mais pour l’étudier plus largement : j’étudie donc le travail de ces intermédiaires que sont les éditeurs, les agents littéraires, les traducteur·ices, leurs principes de sélection et la manière dont iels marquent les œuvres en les classant, ainsi que celui des médiateur·ices qui confèrent aux œuvres une nouvelle signification dans une autre culture, à savoir les préfaciers, critiques, exégètes, etc.
J’appréhende aussi le rôle des instances internationales comme les prix littéraires, notamment le Nobel, qu’ont remporté Mann, Faulkner et Sartre (qui l’a refusé) et, plus près de nous, les festivals de littérature. L’Université contribue de son côté au processus de classicisation en enseignant les œuvres et en produisant des exégèses.
Vous soulignez néanmoins l’évolution – plutôt récente – qui voulait que, très longtemps, la plupart des œuvres classées comme des « classiques mondiaux aient été celles dont les auteurs étaient des hommes occidentaux », jusqu’à la « remise en cause de ce canon littéraire par les féministes et les minorités racialisées ». Comment expliquer ce mouvement qui s’est unifié dans un « champ international », jusqu’à parler de « littérature mondiale » ?
La construction du canon littéraire reposait sur des biais cognitifs des intermédiaires et médiateur·ices. J’ai constaté dans les archives du prix Nobel qu’en 1962 seules trois écrivaines avaient été nominées pour le prix, contre 66 écrivains. Ce nombre augmente légèrement dans les années 1960. Sont habilités à nominer pour le prix les membres d’académies, les représentants des sections du Pen Club, les jurés de prix importants, et les professeurs de lettres. Or, à cette époque, il n’y avait presque que des hommes dans ces positions. De même, seul un écrivain non occidental, Rabindranath Tagore, avait eu le prix jusqu’en 1945.
Les pays du Sud ont commencé à faire pression pour être reconnus à cette époque, mais l’Académie suédoise manquait d’expertise et de traductions. Les minorités étaient largement ignorées car, dans la première moitié du XXe siècle, les recommandations émanaient surtout des académies nationales. Le Nobel n’est bien sûr qu’une des instances de consécration qui peuvent conduire à la canonisation, l’Université joue un rôle important. Le mouvement féministe et le mouvement pour les droits civiques ont remis en cause le canon blanc et masculin dans les universités états-uniennes à partir des années 1980.
Avec la mondialisation, on voit se multiplier des foires du livre partout dans le monde, puis les festivals de littérature, mais aussi les concentrations éditoriales.
L’hégémonie états-unienne, qui commence à la fin des années 1970 et culmine dans les années 1990, fait que ce mouvement s’est propagé, assez lentement cependant, en Europe. Cette diversification est une des caractéristiques de la mondialisation culturelle, et participe aussi d’un mouvement de dénationalisation. Alors que le champ international s’est construit dans l’entre-deux-guerres en s’appuyant sur les identités nationales, l’après-guerre a été marqué par les politiques développementalistes sur fond de guerre froide, et un phénomène de transnationalisation avec l’émergence des foires du livre de Francfort et Londres. Mais le centre de gravité du marché de la traduction restait en Europe.
Avec la mondialisation, on voit se multiplier des foires du livre partout dans le monde, puis les festivals de littérature, mais aussi les concentrations éditoriales, qui transcendent les frontières nationales : les groupes allemands Holtzbrinck et Bertelsmann ont ainsi racheté nombre de maisons d’édition anglophones.
Après les travaux de Pascale Casanova, mais aussi à l’heure de la circulation ultrarapide des informations et surtout des textes, pourquoi utiliser ce concept de « champ littéraire transnational » ? Pourquoi la théorie des champs, issue des travaux de Pierre Bourdieu, vous semble-t-elle un outil central pour expliquer cette « fabrication d’un auteur mondial » ?
Pascale Casanova se référait aussi à la théorie des champs de Bourdieu, même si elle emploie la métaphore plus littéraire de « République mondiale des Lettres (2) ». Elle a montré la centralité de Paris dans cette République, en se focalisant sur les écrivains. Le champ désigne un univers relativement autonome, doté de ses propres règles du jeu et de ses instances de consécration, par exemple les prix littéraires, qui produisent la valeur littéraire.
La République mondiale des Lettres, Pascale Casanova, Seuil, 2008 [1999].
Le champ repose sur une croyance partagée dans la valeur de la littérature, mais aussi sur des luttes de concurrence entre auteur·es et aussi entre intermédiaires, qui sont inégalement doté·es en capital symbolique – par exemple, entre écrivains consacrés et débutants ou entre grands éditeurs et petites maisons indépendantes. Ces luttes se jouent dans chaque champ national et opposent un pôle de production restreinte, où prévaut la valeur littéraire, au pôle de grande production régi par la quête de profit. Le prix Nobel unifie dès le début du XXe siècle la concurrence pour la reconnaissance internationale, mais cette concurrence est arbitrée dans la première moitié du siècle par les rapports de force inégaux entre champs littéraires nationaux.
La transnationalisation brouille les frontières. Outre les foires, dans les années 1960, quelques grands éditeurs européens s’associent pour fonder un Prix international, comme une alternative au prix Nobel : ils ont couronné notamment Borges, Sarraute et Gombrowicz. C’est la traduction de Fictions de Borges chez Gallimard qui avait révélé l’auteur argentin aux éditeurs européens et états-uniens. Les archives révèlent l’intensité des échanges entre éditeurs de différents pays et le fait qu’ils se suivent de près, se consultent et forment des réseaux transnationaux, tout comme les écrivain·es.
À cette époque apparaissent aussi les prix de littérature étrangère, tel le prix du Meilleur Livre étranger en 1948, qui consacre donc des auteur·es traduit·es et jalonne des carrières transnationales : Kawabata l’obtient en 1961, avant d’avoir le Nobel en 1968. Il a été traduit en français, comme Borges, à l’aide du programme des « Œuvres représentatives » mis en place par l’Unesco pour favoriser les échanges avec les pays non occidentaux.
Vous soulignez combien les intermédiaires, depuis longtemps étudiés par la sociologie de la littérature, sont un rouage majeur dans cette « fabrication » d’un auteur mondial (en premier lieu, les traducteurs et éditeurs, les agents, attaché·es de presse, critiques, etc.). Qu’en est-il aujourd’hui avec les nouvelles technologies ? Quelles modifications sont-elles advenues dans la structure de ce « champ international » ?
Je ne pense pas que le rôle des intermédiaires ait disparu. Avant d’être proposé sur Goodreads [un site de suggestions de lecture, N.D.L.R.], un livre doit avoir été édité, « mis en livre », comme dit Roger Chartier, ce qui veut dire aussi se voir attribué un titre, souvent choisi avec l’éditeur. L’image de l’auteur·e, présenté·e sur la quatrième de couverture, est également façonnée par ces intermédiaires. Certes, par-delà l’orientation algorithmique des choix des lecteur·ices, Internet permet aux amateur·ices de s’autodiffuser à une échelle beaucoup plus large qu’auparavant, avec le site Wattpad par exemple, qui est consulté par des millions de lecteur·ices, mais il ne se revendique pas de la « littérature », il s’agit de lire des histoires, c’est un univers parallèle.
On peut s’interroger sur l’avenir de la littérature moderne telle qu’elle a été conçue depuis le romantisme, mais ce pôle existe toujours.
On observe pourtant des interférences et un brouillage des frontières auparavant assez claires entre éditeurs professionnels et autoédition, avec le lancement d’une plateforme d’autoédition par Penguin en 2011, puis le rachat d’une maison d’autoédition l’année suivante. Autre exemple : Cinquante Nuances de Grey a d’abord paru en épisodes en ligne avant d’être publié par un éditeur qui en a décelé le potentiel de rentabilité. Ces exemples témoignent de l’impact accru des contraintes économiques sur le champ éditorial. Dans cette conjoncture, on peut s’interroger sur l’avenir de la littérature moderne telle qu’elle a été conçue depuis le romantisme, mais ce pôle existe toujours, et même sur Internet.
Votre livre se concentre pour une bonne part sur « l’intermédiation », comme l’accès à la traduction ou les instances de consécration que sont notamment les grands prix littéraires. Une intermédiation, écrivez-vous, qui est un ensemble de variables pour la « structure » de ce qui constitue in fine un « champ littéraire transculturel ». Quelles sont ses spécificités, en particulier en ce qui concerne la circulation et la consécration des œuvres ?
Mon enquête montre les inégalités d’accès à la consécration internationale, déjà pointées par Pascale Casanova, mais j’ai tenté de systématiser l’analyse en ajoutant le rôle des intermédiaires. Un ensemble de variables conditionnent cet accès. D’abord la langue d’écriture, celle·ux qui écrivent dans des langues centrales ont plus de chances d’être traduit·es, et notamment si leur tradition nationale est dotée de capital symbolique (comme la littérature française ou américaine).
Les aides à l’extraduction proposés par les États pèsent aussi. Puis le capital symbolique de l’auteur·e, les classiques ou les auteur·es déjà consacré·es au niveau international ont l’avantage sur les débutant·es, dont il faut construire la réputation. À quoi s’ajoutent les inégalités en termes de genre, d’ethnicité et d’origine géographique, et le capital social transnational de l’auteur·e.
Le capital symbolique de l’éditeur est un autre facteur : 29 % des œuvres littéraires traduites du français en anglais dans les années 1990 avaient paru chez Gallimard. Et, bien sûr, il y a les propriétés des œuvres et le genre littéraire, mais les principes d’arbitrage varient selon les circuits et les intermédiaires : certains privilégient l’accessibilité, d’autres l’originalité ; certains mettent en avant l’universalité, d’autres la spécificité culturelle, sous une forme tantôt ethnographique, tantôt exotisante.
Vous concluez votre livre sur la nouvelle « configuration » qu’est la « globalisation » dans la littérature mondiale : féminisation, attention aux minorités et aux migrants, décentrement géoculturel… Les choix des plus grands prix littéraires internationaux reflètent cette évolution – bienvenue, même si tardive, diront certains – qui apparaît clairement dans le nombre des sélectionné·es et celui des lauréat·es. Comment l’expliquer, notamment du point de vue des spécificités et de la structure interne du « champ littéraire transculturel » et/ou « transnational » ?
J’émets l’hypothèse que cette évolution est le produit de l’hégémonie accrue du champ littéraire états-unien, et aussi britannique, sur le champ transculturel, car le Booker Prize est le prix qui féminise et diversifie ses lauréat·es le plus tôt, et les autres jurys ont suivi le mouvement. Le déplacement du centre de gravité de ce champ de Paris à Londres et à New York s’observe au niveau des choix du Nobel : de 1948 à 1990, neuf lauréats du prix du Meilleur Livre étranger ont eu ensuite le Nobel ; désormais, le Booker et le Neustadt ont plus de poids en ce sens. Par ailleurs, la féminisation et la diversification géographique et ethnique des choix du Nobel s’accompagnent d’une domination accrue de la langue anglaise, pratiquée par 13 des 33 lauréat·es de 1990 à 2022.
Pour aller plus loin…

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

Hamad Gamal : « On se demande si nos vies de Soudanais comptent autant que les autres »