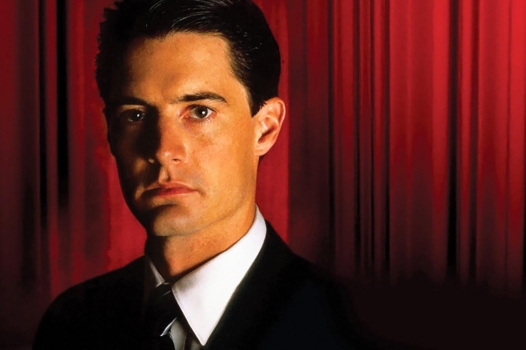« La Vie après Siham », de Namir Abdel Messeeh (Acid)
Le réalisateur appréhende la mort de sa mère toujours et encore par le cinéma.

© Météore Film
La Vie après Siham / Namir Abdel Messeeh / 1 h 16.
Depuis qu’il manie une caméra, Namir Abdel Messeeh n’a cessé de filmer sa famille. Certes, sujet inépuisable. Mais le cinéaste d’origine égyptienne – ses parents sont des Coptes exilés en France – ne se satisfait pas d’en faire une simple chronique. Sa famille est pour lui source d’une aventure cinématographique et d’une inspiration sans bornes, dont témoignait déjà son drolatique premier long métrage, La Vierge, les Coptes et moi (2012), présenté en son temps à Cannes par l’Acid, comme son nouvel opus, La Vie après Siham.
Mais comment faire quand les parents s’en vont ? Que filmer ? N’est-il pas venu le temps de tourner sa caméra vers d’autres horizon ? Siham, la mère du réalisateur, meurt en 2015 d’un cancer. Celui-ci n’a pas d’autre choix : la disparition, le chagrin, la vie de ceux qui restent, en particulier son père, Waguih, il ne peut les appréhender que par le cinéma. D’où La Vie après Siham, dont on peut dire qu’il est un film de deuil bien qu’il ne soit en aucun cas structuré autour de l’absence. Au contraire. C’est un film du trop-plein, qui pullule d’images, peut-être précisément pour repousser la hantise du vide.
Des images de sa mère, en particulier. Il faut dire que Namir Abdel Messeeh filme autour de lui pour un oui pour un non, sa famille le sait, s’en plaint un peu parfois. Mais c’est ce qui lui permet plusieurs tours de passe-passe, grâce au montage, en mêlant les époques. Comme celui de montrer, dans l’appartement de ses parents, la cuisine vide, puis l’instant d’après sa mère s’y affairant, avant de se diriger vers une porte-fenêtre où, derrière, sur le balcon, son mari arrose les fleurs.
Le cinéaste ne s’en tient pas à ses propres images, pourtant foisonnantes. Parce qu’il tente de retracer la vie de sa mère, sa jeunesse et la rencontre de ses futurs parents – en parlant avec son père, en lisant avec lui leur correspondance –, il a recours à des images de films de fiction. En particulier ceux d’un des plus grands cinéastes que l’Égypte a connus : Youssef Chahine. Ainsi, une comédienne interprétant un personnage dans un film (souvent des années 1960) en vient à endosser le rôle de la mère de Namir Abdel Messeeh. Et l’imaginaire dès lors se débride plaisamment.
« Une question de regard »
Un épisode de la vie de sa mère que lui rapporte son père donne une idée de la tournure d’esprit du cinéaste. Waguih lui raconte que le jour où ses parents ont ordonné à Siham de se marier avec son cousin, elle a tenté de se suicider en absorbant vingt sachets d’aspirine. « C’est tragique », dit Waguih. « Ou comique, lui réplique son fils. C’est une question de regard. » Tout est là, en effet.
Pour autant, ce que montre ensuite Abdel Messeeh (nom qui signifie « le serviteur du Messie », souffle-t-il, tout en se demandant pourquoi Namir, prénom nullement égyptien) n’a rien de drôle. Il se rend en Égypte pour retrouver sa tante, auprès de qui il a grandi un temps. Elle lui dit combien la séparation, quand sa sœur Siham l’a repris, lui le petit Namir, a été douloureuse. Il filme aussi les années qui passent, son père qui avance toujours plus en âge et s’apprête lui aussi au grand départ, le plus sereinement possible. En ayant exprimé à leur manière, le fils comme le père – alors que la communication entre eux n’a jamais été leur fort –, l’amour qu’ils se portent.
Le cinéaste n’a rien cédé sur sa foi dans le cinéma, où se mêlent une maîtrise de son art et des croyances souterraines.
Pour qui connaît le chagrin des deuils – nous sommes légion dans ce cas –, ce film fait du bien. Ce n’est pas le moindre de ses mérites, même si ce n’est pas un critère esthétique. Ou plutôt si. C’en est un. Pas seulement parce que le cinéaste ignore tout apitoiement (les larmes sont d’une autre nature, il ne les a donc pas exclues). Aussi parce qu’il n’a rien changé dans sa manière souriante et crâne de défier le système de production cinématographique en concoctant des projets qui ne ressemblent qu’à lui, et qui pourtant parlent à tout le monde. Et qu’il n’a rien cédé sur sa foi dans le cinéma, où se mêlent une maîtrise de son art et des croyances souterraines.
À ses enfants qui regardent leur grand-mère sur des images qu’il a tournées et s’étonnent qu’elle ne leur réponde pas quand ils l’appellent, il leur dit : « Mais c’est un film, Siham ne peut pas vous entendre ! » Certes, mais cette réaction enfantine, il ne s’en est pas départi lui-même : Siham, Waguih et ses autres morts continuent à sacrément exister, pour lui, pour nous, grâce à ses films.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

« Soulèvements », le bien commun en héritage

Thomas Lacoste : « Créer un pare-feu autour de ceux qu’on a érigés en “écoterroristes” »

« Urchin » : marcher sur un fil