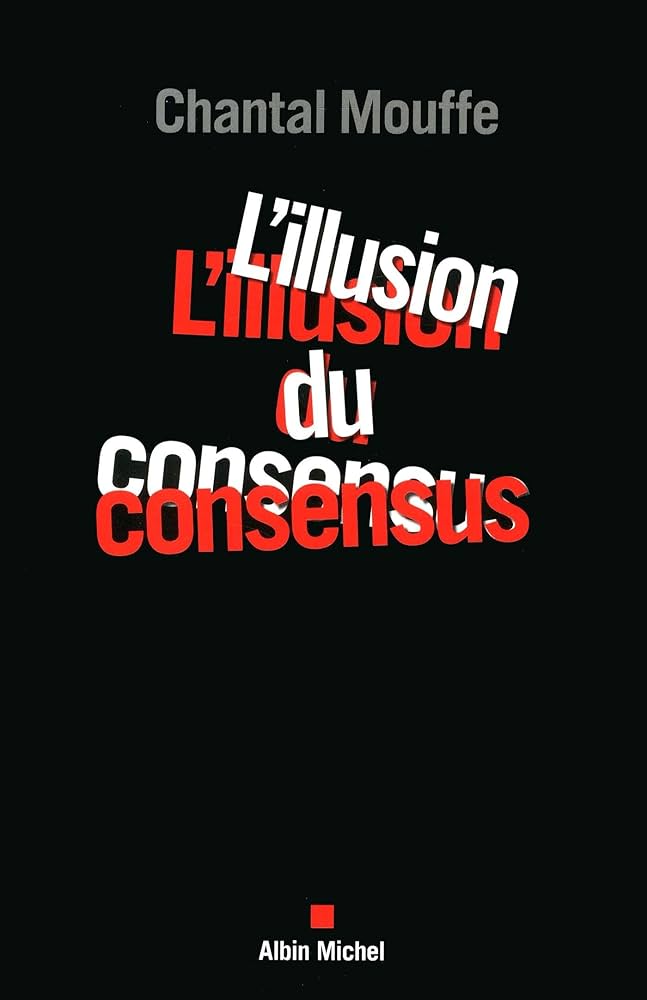Quand la colère ne suffit pas
L’historien Roger Martelli interroge les limites d’une mobilisation fondée sur la conflictualité, à travers une lecture critique de la stratégie populiste de gauche inspirée par Chantal Mouffe et adoptée notamment par Jean-Luc Mélenchon.
dans l’hebdo N° 1872-76 Acheter ce numéro

© Lily Chavance
Dans le même dossier…
Le ressentiment, passion triste et moteur des replis identitaires Info en continu : une sensation de partage De la honte à la lutte : émotions décoloniales et engagement collectif Gouverner par la peur : démocratie sous tension« Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas » : tout le monde connaît la formule célèbre de Jean-Luc Mélenchon. Elle date de novembre 2010. Celui qui était alors le leader du Parti de gauche en usait pour dire que l’alliance de l’époque, le Front de gauche, n’était pas un « supplétif de circonstance » du Parti socialiste et qu’il récusait toute « coalition contre-nature ».
En 2016, il trouve une légitimation doctrinale de son propos dans le livre de la philosophe Chantal Mouffe, L’Illusion du consensus (Albin Michel). Celle-ci se réfère en effet explicitement à la pensée du théoricien réactionnaire de l’entre-deux-guerres Carl Schmitt, qui faisait du couple « ami-ennemi » le pivot du vieux conflit du « eux » et du « nous ». Considérant que la rationalité ne suffit pas à mettre le peuple en mouvement, elle cherche à définir les « affects mobilisateurs », qu’elle trouve dans l’opposition du peuple et de l’élite.
La radicalisation de la social-démocratie étant désormais impossible et le clivage de la droite et de la gauche étant dépassé, il n’y a pas d’autre solution, face à l’extrême droite montante, que de mobiliser la colère pour rendre hégémonique un « nous » populaire reprenant le drapeau de la souveraineté nationale bafoué par les élites. C’est, dit-elle, la mission d’un « populisme de gauche » que de tourner cette colère non vers les migrants, mais vers l’élite financière et politique.
Le peuple sociologique n’est pas en lui-même un peuple politique.
La mobilisation des affects l’emporte pragmatiquement sur le contenu des alternatives opposées à l’élite. Attiser directement la colère compte plus que la construction patiente de rassemblements politiques dont on se défie a priori. Or, ce faisant, le propos cohérent de Chantal Mouffe tourne le dos à l’histoire en très longue durée du combat populaire pour l’émancipation. Le peuple sociologique n’est pas en lui-même un peuple politique. Il n’est que la somme des catégories populaires, des exploités, des dominés, en bref des subalternes.
Quand ces fragments s’assemblent pour lutter, ils se constituent en multitude agissante, en « mouvement ». Mais la multitude ne devient pleinement un peuple politique que si elle se révèle à la fois contre et pour. Moins contre d’autres groupes (les exploitants, les dominants) que contre le système qui produit l’opposition des dominants et des dominés. Non pas pour que ceux d’en bas deviennent ceux d’en haut, mais pour que la logique de polarisation des classes ne soit plus un principe éternel de classement.
Glissement
Le peuple ne s’impose en protagoniste politique conscient que lorsqu’il peut opposer à l’ordre inégalitaire réel non pas seulement un catalogue programmatique, mais un projet fondé sur l’égalité, assorti d’une stratégie de long terme qui ne se réduit pas à un moment électoral salvateur. À vouloir se polariser sur l’adversaire contre qui doit se tourner la colère, on court le risque de mettre au second plan la cause des maux, des colères et des peurs. Le risque, donc, de laisser s’opérer le glissement qui va du responsable, qu’on ne voit pas toujours, au bouc émissaire, toujours à portée de main.
Il ne sert à rien de railler le bruit et la fureur, empruntés par Mélenchon à Shakespeare et à Faulkner. Les mots disent la réalité de la colère et le besoin de radicalité pour l’assouvir. Mais en se polarisant sur la colère en elle-même, ils font courir le risque d’en faire un raccourci dispensant de l’essentiel en matière d’émancipation : le travail persévérant de reconstruction de l’espérance. Et le risque aussi d’oublier que la colère contre l’injustice s’accompagne volontiers du refus du chaos et que l’inquiétude face à un monde violent et dangereux peut nourrir à la fois l’aspiration à la vengeance et le désir d’être rassuré.
Une radicalité qui mobilise et qui rassure en même temps.
Une radicalité qui mobilise et qui rassure en même temps, qui ne se contente pas d’attiser, mais qui incarne la possibilité d’une société rassemblée et apaisée : c’est au bout du compte plus subversif que toute agressivité du verbe, même brillante.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Clémentine Autain : « Nous devons avoir le discours d’une gauche décomplexée »

« Donald Trump entre en confrontation avec la Constitution »

Le drapeau, projection de l’individu social