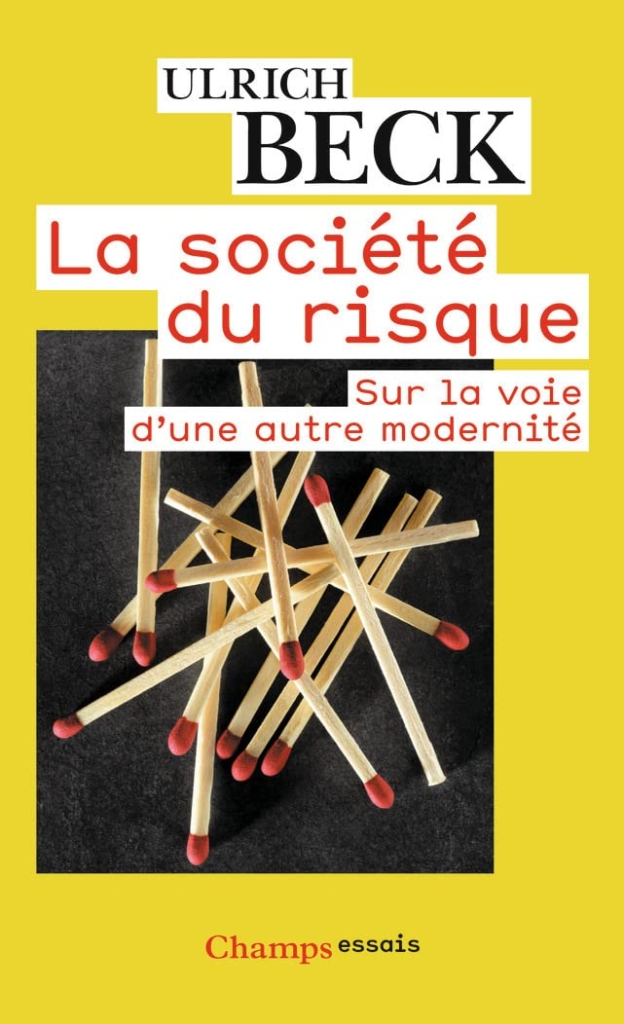Le ressentiment, passion triste et moteur des replis identitaires
Dans ce texte puissant et lucide, l’historien Roger Martelli analyse les racines profondes d’un mal-être né des blessures sociales et de l’impuissance à agir. À rebours des discours simplificateurs, il en retrace les usages politiques, notamment dans la montée des extrêmes droites, qui savent capter et détourner cette colère refoulée vers l’exclusion et la stigmatisation de l’autre.
dans l’hebdo N° 1872-76 Acheter ce numéro

Dans le même dossier…
Quand la colère ne suffit pas Info en continu : une sensation de partage De la honte à la lutte : émotions décoloniales et engagement collectif Gouverner par la peur : démocratie sous tensionLe ressentiment est l’un de ces affects dont on redécouvre aujourd’hui ce que l’on sait pourtant depuis longtemps : qu’il détermine l’action des humains au moins autant que la raison que privilégiaient à juste titre l’Humanisme et les Lumières. En fait, il a été étudié largement par les philosophes, les psychologues et les psychanalystes. Il a été scruté par les historiens, qui ont suivi ses cheminements des révoltes d’esclaves de l’Antiquité jusqu’aux soubresauts du XXe siècle. Cette passion triste est enfin un phénomène de notre temps, un des ressorts majeurs qui poussent des millions d’individus vers les héritiers multiformes des fascismes, en expansion sur tous les continents.
Le bouc émissaire idéal, celui dont le sacrifice rituel lave la société tout entière de ses maux, c’est volontiers l’étranger.
Écoutons au départ l’historien Marc Ferro : « À l’origine du ressentiment chez l’individu comme dans le groupe social, on trouve toujours une blessure, une violence subie, un affront, un traumatisme. Il rumine sa vengeance qu’il ne peut mettre à exécution et qui le taraude sans cesse. Jusqu’à finir par exploser (1). » Le ressentiment naît donc de la souffrance et du déni, comme la colère naît de l’injustice faite à soi-même ou comme l’indignation procède de l’injustice faite à autrui. Mais, à la différence de ces deux affects voisins, il se nourrit de l’impuissance à agir contre ce qui cause la blessure et de la frustration de ne pouvoir s’en venger.
Le Ressentiment dans l’histoire. Comprendre notre temps, Marc Ferro, éditions Odile Jacob, 2007.
Avec le temps, tandis que la colère peut retomber, le ressentiment devient une façon d’être au monde qui s’applique de façon universelle et durable, d’autant plus tentée de s’étendre qu’on ne sait plus vraiment où se trouve la responsabilité de la douleur. Qui est responsable des maux sociaux qui nous frappent ? Les maîtres de l’économie ? Ils ne se voient pas, brouillés par la valse des spéculations boursières, des participations, des sous-traitances, des prête-noms. La mondialisation capitaliste ? Oui, mais ses circuits sont opaques. La circulation financière ne se voit pas ; celle des hommes au contraire se perçoit, avec ces migrations croissantes des pauvres, dont on nous dit que ce sont elles qui cassent le sacro-saint « marché du travail ».
Le ressentiment n’est, au départ, rien d’autre que de la colère refoulée qui ne sait plus contre quoi se tourner et qui ne trouve pas les ressorts pour réagir. On ne croit plus à rien, donc on se méfie de tout. Il est alors facile de s’accrocher à des mots si vagues que l’on peut y mettre à la fois tout le monde et personne. On vitupère, en vrac, l’élite, la caste, l’establishment, la nomenklatura, les bobos, le politiquement correct… Mais tout cela ne suffit pas pour mobiliser les affects.
Le confort du bouc émissaire
Quand on ne voit pas le système qui aliène les individus, le plus simple est de montrer du doigt le responsable. Et le plus commode n’est pas alors celui qui est caché, mais celui qui est le plus visible, parce qu’il est le plus près. Le bouc émissaire idéal, celui dont le sacrifice rituel lave la société tout entière de ses maux, c’est volontiers l’étranger, le concurrent des matins d’embauche, hier le Belge, le Polonais ou l’Italien, en longue durée le juif et aujourd’hui le musulman.
C’est ainsi que la colère contre l’injustice ou le mépris se mue en désir de vengeance, en haine et en négation de l’autre. Au bout du temps et des haines accumulées, cette négation d’autrui finit par l’emporter sur une affirmation de soi que l’on n’a plus la force d’exprimer. Le ressentiment est le propre des « faibles », de ceux qui ne peuvent ni agir ni réagir, expliquait Friedrich Nietzsche. Le constat a été tiré trop souvent vers le pire ; il n’était pas pour autant si faux…
Il se trouve que ces glissements sont d’autant plus forts que s’affaiblissent les grandes représentations porteuses de sens partagé. Dès lors que l’horizon s’obscurcit, que la sécurité vacille et que la croissance s’enraye, que le travail se fait incertain, l’autonomie de l’individu peut fort bien se muer en solitude, la solitude en angoisse et l’angoisse en traumatisme. Le ressentiment peut alors devenir la seule manière dont se rassemblent ceux qui sont dispersés.
Nous sommes plongés aujourd’hui dans la « société du risque (2) », non pas une société où il y a du risque – quelle société n’en comporte pas ? –, mais une société où le risque, sous toutes ses formes, devient un élément régulateur du lien social. Le recul de l’espérance sociale ouvre la voie à un ressentiment grandissant dans des catégories populaires qui avaient obtenu depuis peu une reconnaissance statutaire et une redistribution partielle des richesses par l’entremise de l’État.
La Société du risque, Ulrich Beck, traduit de l’allemand par Laure Bernardi, Flammarion, coll. « Aubier », 2001.
La crise de la rationalité, la foi défaillante dans le progrès illimité, les brouillages de l’espoir d’égalité, les échecs de l’émancipation et le poids des incertitudes suscitent à terme les violences du désespoir, le repliement sur soi ou un retour au religieux que le ressentiment pousse volontiers jusqu’au fanatisme.
Le ressentiment est donc la colère qui ne sait pas désigner sa cible. Il fait que la désillusion et le désespoir ne tournent pas à la combativité, mais à la haine. Et c’est à ce moment-là que l’on trouve l’extrême droite sur notre chemin. Elle se réclame du peuple, mais elle se tourne d’abord vers le peuple qui doute de lui-même, qui se désespère et ne sait plus de quel côté se tourner.
Ressort historique de tous les fascismes : en l’attisant, ils laissent entendre à une partie des catégories populaires qu’ils les comprennent. Ils ne font pas toutefois de ces catégories un peuple souverain, mais une multitude dépendante dont la douleur s’atténue dans le fantasme et dont la capacité de décider et d’agir par soi-même s’enlise dans l’attente de l’autorité et de la personnalité salvatrice.
L’extrême droite a développé dès les années 1970 l’hypothèse selon laquelle le temps n’est plus à l’égalité mais à l’identité.
Pour parvenir à ses fins, l’extrême droite a travaillé patiemment sur le terrain des idées. Elle a développé dès les années 1970 l’hypothèse selon laquelle le temps n’est plus à l’égalité, comme au XIXe et au XXe siècle, mais à l’identité. Qui sommes-nous ? Sommes-nous toujours bien ce que nous étions ? Et n’est-on pas en train de nous conduire à ne plus être ce que nous étions ? Le Front national de Jean-Marie Le Pen s’est ainsi glissé habilement dans le sillage du « choc des civilisations », inventé outre-Atlantique, qui opposerait un Occident en déclin démographique et en perte de sens à un Islam expansif démographiquement et doctrinalement.
Il s’est appuyé surtout sur le ruissellement de la thématique identitaire vers les représentations populaires. « Nous devons préserver notre identité » est la formule savante ; l’expression populaire est : « On n’est plus chez nous. » Quand les deux se rejoignent, l’apparence se fait dogme partagé. « Certains » veulent nous imposer d’être ce que nous ne sommes pas. « Ils » nous submergent de leurs voiles, de leurs menus particuliers dans les cantines, de leurs fêtes et de leurs odeurs. Nous ne savons plus trop ce que nous sommes, mais jusqu’à présent nous étions chez nous ; or nous sommes en passe de ne plus y être.
Refonder l’espérance
Depuis, la force de l’extrême droite « marinisée » a été de raccorder la passion triste multiséculaire et un projet contre-révolutionnaire recevable. Dans un monde dangereux et des sociétés éclatées, la protection devient l’alpha et l’oméga. La frontière nationale est un fantasme assez fort pour multiplier l’érection des murs. Le nationalisme exclusif redevient une vertu. Quoi de plus naturel, si les ressources ne sont plus expansibles à l’infini, que d’écarter de la table les non-nationaux et les « assistés » qui ne le méritent pas ?
On ne lutte pas contre le ressentiment en le flattant ou en attisant la colère, mais en créant les conditions pour que la colère retrouve le socle qui lui donnait du sens et qu’elle a perdu, celui de la solidarité conjuguée à l’espérance. L’antidote du ressentiment, c’est donc le projet de société qui écarte la possibilité de la blessure et qui délégitime tout à la fois la violence, l’injustice et la discrimination.
L’antidote du ressentiment, c’est le projet de société qui écarte la possibilité de la blessure.
La formalisation de ce projet et le récit qui le fait vivre permettent de dépasser le sentiment d’impuissance. Ils dissocient la colère et la haine, l’indignation et la rancœur. Ils remettent l’égalité au cœur de l’action sociale au détriment de l’identité. Ils redonnent à l’émancipation la force de réalisme que l’on attribue indûment aujourd’hui à la seule puissance.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Clémentine Autain : « Nous devons avoir le discours d’une gauche décomplexée »

« Donald Trump entre en confrontation avec la Constitution »

Le drapeau, projection de l’individu social