Christian Prigent, un poète dans la cité
Avec Zapp & Zipp 2018-2024, l’auteur publie le deuxième tome de son journal. Il y développe une réflexion passionnante sur le langage poétique, réfléchit sur la société d’aujourd’hui et sur sa propre histoire. Rencontre chez lui, à Saint-Brieuc.
dans l’hebdo N° 1886 Acheter ce numéro

© Vanda Benes
Saint-Brieuc, cité des poètes. Ce n’est pas le syndicat d’initiative de la ville qui le revendique. C’est le constat qui vient à lire le nouvel opus de Christian Prigent, le deuxième volume de son journal : Zapp & Zipp. On y lit ceci : « André Breton : petite enfance à Saint-Brieuc (Les Champs magnétiques en portent la trace) ; […] cite toujours comme précurseurs ses Briochins favoris : Lequier, Villiers, Corbière, Jarry… » C’est donc tout naturellement que nous avons rejoint Christian Prigent chez lui, sur les terres où il est né et a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans, quand il lui a fallu partir à l’université de Rennes. Et où il est retourné s’installer après une carrière d’enseignant dans le secondaire.
Tout écrivain rêve d’en arriver au moment où il sera légitime à ses yeux de publier son journal.
C. PrigentQuelques semaines plus tôt, il avait été aperçu à la Maison de la poésie à Paris, où on lui consacrait un « jubilé » pour son 80e anniversaire. Une quarantaine d’artistes et de poètes s’étaient succédé sur scène pour lire des extraits de son œuvre. Œuvre fondamentale – citons notamment Grand-Mère Quéquette (2003), Météo des plages (2010), ou Chino au jardin (2021) (1) –, l’une des plus fécondes de ces cinquante dernières années, polymorphe (livres de poésie, essais, romans, journaux), nerveuse et inquiète, grinçante et carnavalesque. Très peu présente – euphémisme ! – dans les radars de la critique journalistique en manque de repères.
Après Point d’appui 2012-2018 (2019), voici la suite chronologique de son journal, qui couvre la période allant de 2019 à 2024, Zapp & Zipp. « Tout écrivain rêve d’en arriver au moment où il sera légitime à ses yeux de publier son journal, qui permet la liberté de formes, la variété des registres d’écriture, de parler de tel ou tel sujet de société, sans que se soulève l’exigence impressionnante d’un accomplissement formel », confie Christian Prigent.
"Mettre en tension"L’écriture ainsi quotidienne du journal s’est imposée à lui il y a un peu plus de dix ans, légitimée par l’œuvre déjà accomplie, et avec laquelle les résonances sont évidemment nombreuses. Peut-être plus encore que dans le volume précédent, parce qu’il y a dans Zapp & Zipp une interrogation récurrente, obsessionnelle : qu’est-ce qui fait la spécificité de la poésie ?
À peine Prigent a-t-il tenté une réponse qu’il en formule une autre quelques jours plus tard, et ainsi de suite, voyant dans le langage poétique la nécessité de « mettre en tension » la phrase (le sens) et le phrasé (le rythme), avec ceci pour objectif : « Ce qui gêne les parlants aux entournures de la pensée, c’est l’intuition que leurs vies sont habitées d’une é-normité qui ne peut se représenter puisque toute représentation est normée par ses codes. Pourtant c’est au rêve d’y parvenir que s’accrochent les pensées des hommes. L’histoire de l’art est l’histoire de cet acharnement. La poésie tente de mettre dans le fini des représentations verbales un peu plus d’infini que ne le fait la moyenne des écrits. »
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…
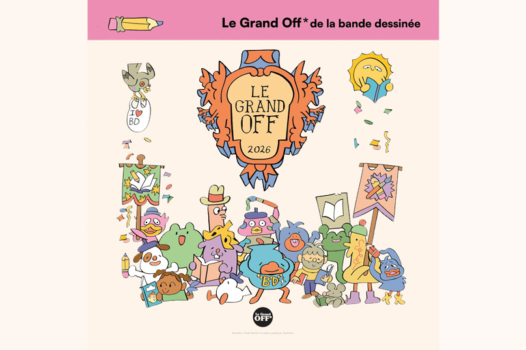
Malgré Angoulême, fêter la BD malgré tout

« Viens Élie », l’arbre et la forêt

« Trop tard », l’extrême droite à la sauce Popeye







