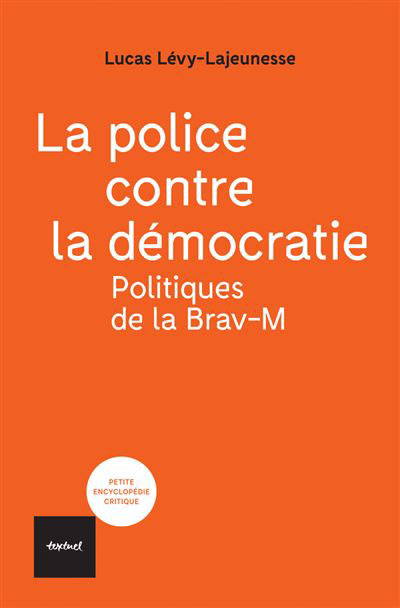Dominer et soumettre : un idéal qui traverse l’histoire des institutions policières
Dans une tribune, Lucas Lévy-Lajeunesse, professeur de philosophie, membre de la LDH et auteur d’un livre sur la Brav-M, revient sur les dérives de ces brigades, alors que s’est ouvert le 3 avril dernier un procès d’agents, pour des violences commises lors d’une manifestation en 2023 contre la réforme des retraites.

© Maxime Sirvins
Le 3 avril dernier commençait le procès d’agents de la Brav-M, mis en cause par un enregistrement effectué à leur insu en mars 2023, qui révélait leurs pratiques brutales à l’égard de personnes interpellées lors d’une soirée de manifestations. Les policiers s’en étaient particulièrement pris à la seule personne noire du groupe, Monsieur S., qui subissait coups, menaces, propos racistes, homophobes et sexistes. Son avocat, Arié Alimi, a pu faire apparaître les contradictions des agents en les conduisant par ses questions à passer, en l’espace de quelques secondes, d’une version à une autre devant le tribunal.
Deux ans plus tôt, dès la révélation de l’affaire, les défenseurs de l’institution policière déclinaient leur argument sempiternel : « Le comportement de quelques individus ne doit pas jeter l’opprobre sur toute une unité », expliquait le préfet de police Laurent Nuñez. Mais quel opprobre ? Loin de déshonorer la Brav-M, l’affaire n’exprime-t-elle pas plutôt avec limpidité son essence même : une police violente et intimidante ? Les agents mis en cause ont-ils appliqué d’autres principes que ceux d’une brigade façonnée pour l’intimidation, la répression, les interventions choc et le quadrillage des quartiers populaires ? La création de la Brav-M devait-elle servir à autre chose qu’à soumettre, par la menace et par les coups, les publics dont les autorités préfèrent qu’ils se fassent discrets ?
Pour plaider leur cause, les agents impliqués ont dénoncé lors de l’enquête le comportement provocant de leur victime, coupable de « sourires », de « regards », d’« arrogance » et d’« insolence ». « Considérez-vous Monsieur S. comme votre égal ? » a demandé lors de l’audience Chloé Saynac, l’avocate de la Ligue des droits de l’Homme. « Non, pas du tout ! », répondait du tac-au-tac un agent dans un lapsus sans doute révélateur puisque les policiers expliquent qu’ils cherchaient à garder l’« ascendant », dans ce qu’ils ont vu comme un « combat de coqs ».
Qu’est-ce qui pousse le préfet de police à se montrer solidaire de policiers aux agissements si graves ?
Les reproches adressés à leur victime montrent en creux que la seule attitude valable de la part de ce « renoi » (expression d’un agent enregistré), la seule qui lui aurait peut-être permis d’éviter les coups et la séance d’humiliation, aurait été de baisser les yeux et d’afficher, en signe de soumission, la mine contrite qui était attendue de lui. Dominer et soumettre : voilà un idéal qui traverse l’histoire des institutions policières et trouve aujourd’hui l’une de ses expressions dans l’existence de la Brav-M. En créant cette dernière en 2019, après des semaines de polémiques sur les violences policières, les pouvoirs publics faisaient passer un message. Ils lançaient dans la rue une brigade violente et effrayante dont ils ne pouvaient pas ignorer qu’elle rappellerait immédiatement les voltigeurs, meurtriers de Malik Oussekine en 1986.
Mais « nous ne sommes pas devant votre juridiction pour faire le procès de la Brav-M », s’inquiétait l’avocat de l’un des mis en cause. Quel sens donner alors au fait qu’aucun des policiers, tous engagés dans la Brav-M sur la base du volontariat, n’ait tenté de mettre fin aux coups et aux humiliations, préférant soit participer, soit profiter en spectateur hilare ? Mais la Brav-M n’est après tout que l’une des représentantes de ce que la police française sait faire de pire. L’affaire devrait peut-être donc moins mettre en question la seule brigade que l’institution policière en elle-même.
Laurent Nuñez, l’un de ses plus éminents dirigeants, juge certes « inacceptables » les comportements des policiers enregistrés. Il tient toutefois à nuancer, affirmant peu après l’affaire que « les propos qui sont tenus sont graves, mais ce sont des paroles ». C’est peut-être cette surdité aux coups qui l’a conduit, contre l’avis des services de la préfecture, à accorder la protection fonctionnelle aux policiers mis en cause. Depuis, les violences ont été avouées, mais Laurent Nuñez déclarait il y a quelques jours, à l’occasion de la tenue du procès, qu’« en tout cas, [ces agents] resteront évidemment dans la police nationale, bien sûr ». Le tribunal pourrait pourtant prononcer des interdictions d’exercer. Qu’est-ce qui pousse alors le préfet de police à se montrer solidaire de policiers aux agissements si graves ?
Laurent Nuñez passe parfois pour un modéré tant son prédécesseur, Didier Lallement, avait ouvert la « fenêtre d’Overton » de ce que peut dire et faire un préfet de police. Mais il partage le même attrait pour la brutalité. En témoignent des propos effarants tenus en mars 2019, alors qu’il était secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur. Annonçant une politique nouvelle qui allait notamment donner naissance à la Brav-M, Laurent Nuñez déplorait comme un « dysfonctionnement majeur » le fait que le 16 mars 2019, alors qu’une manifestation de Gilets jaunes avait conduit au saccage du Fouquet’s, « certains services [avaient] reçu pour instruction de faire un usage plus mesuré des LBD ».
« En comparaison, expliquait-il, on avait comptabilisé 2 900 tirs le 8 décembre [2018] ». Pour quel bilan ? Selon le décompte de David Dufresne, le 16 mars 2019, une personne perdait un œil à Paris à cause d’un tir de LBD, alors que quatre étaient éborgnées pour les mêmes raisons le 8 décembre 2018.
Les opérations de « maintien de l’ordre » (quel ordre ?) ont certes pour enjeu la protection des biens. Le fait que celle-ci soit souvent présentée comme si elle primait sans débat sur les libertés publiques ne cesse d’inquiéter. Mais fait qu’elle prime même sur la sécurité et l’intégrité physique des personnes, quitte à les mutiler, est le signe d’une radicalisation sévère des responsables politiques et policiers.
Ces policiers (…) n’ont finalement pas dérogé aux standards actuels de leur institution.
En considérant comme un « dysfonctionnement majeur » ce qui avait réduit le nombre de personnes éborgnées, L. Nuñez témoignait son indifférence à l’un des principes éthiques les plus basiques et fondamentaux : celui qui donne à l’intégrité de la personne humaine une valeur incommensurable avec celle de biens matériels tels que le mobilier d’un restaurant de luxe. Il est dès lors tout naturel que le préfet de police considère, à propos d’agents qui cognent sans raison et qui s’amusent à humilier les personnes qu’ils ont interpellées, qu’ils « ont encore toute leur place dans la police ». Ces policiers, malgré l’outrance de leur conduite, n’ont finalement pas dérogé aux standards actuels de leur institution.
Jérôme Foucaud, l’un des plus hauts responsables de la police française, surnommé en interne le « bienfaiteur de la Brav-M », déclarait en 2024 que les agents enregistrés « se font piéger » puis « racontent des conneries », des « bêtises » : les menaces, les coups, les propos racistes, etc. Il expliquait le même jour que la police est « organisée pour s’autosurveiller » et « se surveille plutôt beaucoup », mais que les recours en justice posent problème, car ils produisent une « insécurisation juridique des forces de l’ordre ». Celle-ci « complique [leur] tâche » puisqu’« évidemment, ça insécurise les policiers, et les policiers, avant d’agir, réfléchissent maintenant » (!). Est-ce pour prévenir ce sentiment d’insécurité que l’administration a décidé de ne sanctionner que deux des dix agents dont se tient désormais le procès, d’un blâme pour l’un et de trois jours de suspension pour l’autre ?
Espérons que la justice joue son rôle de contrepouvoir.
Cette affaire est donc sans doute moins celle de la Brav-M que l’énième affaire d’une institution radicalisée à la base et au sommet, dont la célèbre brigade n’est qu’une émanation particulière et particulièrement révélatrice. Face à cette police, qui voudrait s’« autosurveiller » seule et que le pouvoir exécutif encourage depuis des années dans ses pires tendances, espérons que la justice joue son rôle de contrepouvoir et que le tribunal envoie un message, en prononçant des interdictions d’exercer lors du délibéré en juillet.
Lucas Lévy-Lajeunesse est professeur de philosophie et membre de la Ligue des droits de l’Homme, au sein de laquelle il participe depuis 2019 aux travaux de l’Observatoire parisien des libertés publiques. Il est l’auteur du livre La police contre la démocratie. Politiques de la Brav-M (Textuel, 2025).
Des contributions pour alimenter le débat, au sein de la gauche ou plus largement, et pour donner de l’écho à des mobilisations. Ces textes ne reflètent pas nécessairement la position de la rédaction.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

« Samedi 21 février, l’extrême droite marche dans les rues de Lyon, et nous continuerons à résister »

Affaire Deranque : interdire le savoir, le piège de l’ordre public contre les libertés fondamentales

Némésis : la dissolution nécessaire que personne ne mentionne