« La violence est un attribut politique constant de l’extrême droite »
À l’occasion du délibéré du procès des membres de l’Action des forces opérationnelles (AFO), groupuscule qui prévoyait des attentats contre les musulmans, les chercheurs Baptiste Roger-Lacan et Emmanuel Casajus reviennent sur le rapport historique de l’extrême droite à la violence.

Baptiste Roger-Lacan est historien, spécialiste de la contre-révolution. Il a dirigé l’ouvrage collectif Nouvelle histoire de l’extrême droite, qui paraîtra au Seuil le 10 octobre. Parmi les contributeur·ices, le sociologue Emmanuel Casajus, spécialiste des groupuscules radicaux. Ensemble, ils évoquent le rapport de l’extrême droite à l’histoire coloniale et à la Seconde Guerre mondiale. Interview croisée.
Dans votre ouvrage, vous évoquez la façon dont l’extrême droite investit la rue, la presse et l’édition dans l’entre-deux-guerres pour faire entendre son discours notamment autour de « l’Anti-France ». Peut-on faire un parallèle entre cette période et celle que nous vivons aujourd’hui ?
Baptiste Roger-Lacan : Le jeu de l’analogie est toujours délicat mais il est si présent médiatiquement que l’on est obligé de s’y confronter. Je ne pense pas qu’on puisse dire qu’il existe une « résurgence » des années 1930, parce que cela écrase la singularité de l’époque dans laquelle on vit. Par contre, quand on se pose du point de vue de l’étude de l’extrême droite, on constate qu’il y a des permanences qui ressurgissent. Il y a l’idée, par exemple, qu’il y aurait une communauté organique à défendre et menacée à la fois de l’extérieur et de l’intérieur par des agents qui chercheraient à fracturer son unité.
Un autre élément très fort à noter, c’est que la violence est un attribut politique constant de l’extrême droite. Il s’agit de la pratiquer contre ses adversaires, bien sûr, mais aussi de la revendiquer et de la célébrer : pour une partie des factions d’extrême droite, la violence est perçue, depuis l’entre-deux-guerres, comme nécessaire mais aussi porteuse d’une vertu dans sa capacité à purifier le corps social.
Emmanuel Casajus : Je voudrais revenir sur les idées d’« Anti-France » et d’« invasion ». Aujourd’hui, la première est souvent utilisée chez CNews, par Pascal Praud notamment. La seconde a été reconstituée par le concept raciste de Renaud Camus, le « grand remplacement ». Ce qu’il faut noter, c’est le changement de cible en passant des juifs aux musulmans, bien que l’antisémitisme perdure à l’extrême droite. Sur ce sujet précisément, c’est plus intéressant stratégiquement pour elle de pointer du doigt La France insoumise comme étant les « véritables » antisémites.
Il faut noter un changement de cible en passant des juifs aux musulmans, bien que l’antisémitisme perdure à l’extrême droite.
E. CasajusMais, en même temps, certaines franges de l’extrême droite peuvent mal vivre ce nouveau glissement. On assiste aussi à la résurgence d’un antisémitisme violent, mais codé. Par exemple, Matthieu Valet, l’ancien policier devenu député européen du Rassemblement national, a fait plusieurs posts où il disait que LFI était antisémite tandis que son parti défendait, lui, « le juif ». Une référence implicite à Édouard Drumont et à toute une prose antisémite, qui objectivaient les juifs de cette manière.
Comment ces références sont-elles prises en charge par les groupuscules ?
E.C. : Ce sont eux qui s’inspirent le plus des idéologies
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

Au quartier pour mineurs de la prison de Metz, « sans liberté, on fait comme on peut »
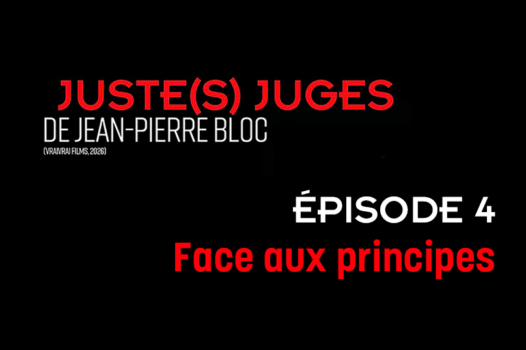
Juste(s) juges – Épisode 4

« L’expression “ferme France” perpétue un imaginaire paysan bleu-blanc-rouge »







