« Sur l’Adamant » : « Le miroir grossissant de nos vulnérabilités »
Vingt-cinq ans après « La Moindre des choses », Nicolas Philibert revient avec un film, Ours d’or à Berlin, tourné au sein d’un établissement où la psychiatrie est encore pratiquée de manière humaine.
dans l’hebdo N° 1754 Acheter ce numéro

© Les films du Losange.
En 1996 sortait sur les écrans La Moindre des choses, film réalisé par Nicolas Philibert, qui avait posé sa caméra à la clinique de La Borde, haut lieu de la psychothérapie institutionnelle, qui donne le primat à la relation entre soignants et soignés, pendant toute la durée de préparation du spectacle qui y a lieu chaque année. Plus de vingt-cinq ans plus tard, le cinéaste aborde à nouveau le territoire de la folie, dans un lieu situé sur la Seine à Paris, l’Adamant, lui aussi régi selon la même « philosophie » de soins.
Sur l’Adamant, Nicolas Philibert, 1 h 49.
Comme d’habitude, le regard de Nicolas Philibert voit profondément mais en douceur. Sans mentir sur leur vulnérabilité, le réalisateur montre des patients riches d’un monde qu’ils portent en eux, avides de liens avec les autres, nourris pour beaucoup par les activités artistiques auxquelles ils s’adonnent, d’une lucidité souvent impressionnante et certainement surprenante pour qui ne les fréquente guère, c’est-à-dire pour la plupart des spectateurs.
Sur l’Adamant, œuvre forte et subtile ayant obtenu l’Ours d’or à la dernière Berlinale, sera suivi de deux autres documentaires sur le même thème avec des angles différents, le cinéaste ayant ainsi bouclé un triptyque sur la maladie psychique. Comme il le dit dans cet entretien, il y a « urgence » à reconsidérer la psychiatrie, depuis trop longtemps délaissée. Le faire avec Nicolas Philibert est un gage de grande conscience.
Vous débutez Sur l’Adamant comme La Moindre des choses, par une séquence dans laquelle quelqu’un chante. Est-ce pour marquer le lien entre les deux films ?
Nicolas Philibert : Non, pas du tout. Les deux films ont des points communs, tout en étant très différents, mais c’est simplement parce que, dans les deux cas, cela me semblait un bon début. Si j’ai choisi d’ouvrir Sur l’Adamant par une séquence dans laquelle un patient chante « La Bombe humaine », la chanson du groupe Téléphone, c’est parce qu’elle résonne de façon frappante avec l’univers de la psychiatrie. En la chantant, François l’incarne tellement que c’est comme si on en redécouvrait la portée. Et puis il y a cette phrase, l’une des toutes premières de la chanson, qui est comme une adresse aux spectateurs : « Je veux vous parler de moi, de vous ! » comme pour dire le fil qui nous relie tous.
Bien entendu, pour pouvoir utiliser la chanson, nous avons dû demander l’autorisation et négocier les droits auprès d’Universal, et cela a pris un certain temps. Au bout du compte, Universal a envoyé la séquence aux musiciens de Téléphone, et ils ont dit oui. Quand j’ai annoncé à François qu’ils l’avaient vu chanter leur chanson, il en a été bouleversé.
Pourquoi avoir voulu faire un nouveau film sur une structure de soins psychiques ?
Quand j’ai fait La Moindre des choses, l’idée d’un film à La Borde ne venait pas de moi. Des amis qui travaillaient en psychiatrie m’avaient incité à le faire, et au début cela ne me disait rien. J’avais de profonds scrupules à l’idée d’introduire une caméra dans un lieu comme celui-là. La souffrance psychique n’est pas un spectacle !
Mais les amis revenaient régulièrement à la charge, et au bout d’un an j’ai fini par céder. J’ai décidé d’y passer quelques jours, pour voir. Une fois sur place, des patients et des soignants se sont mis à m’encourager. J’avais peur d’être intrusif ? D’instrumentaliser les patients ? Eh bien ils allaient m’aider à me confronter à mes peurs, à mes réticences. Pour les dépasser. J’ai fini par faire le film en partie pour cela.
Et voilà que vingt-cinq ans plus tard je décide de revenir en psychiatrie, dans un lieu certes très différent, mais qui relève sensiblement de la même approche ! Comme s’il y avait urgence à en « remettre une couche ». Parce qu’entre-temps le contexte a changé, la pression économique est devenue beaucoup plus forte et la psychiatrie s’est profondément dégradée. Elle est à bout de souffle, comme sacrifiée par les pouvoirs publics : restrictions budgétaires, manque de moyens, de lits, de personnel soignant, manque d’attractivité, retour aux chambres d’isolement.
La psychiatrie est à bout de souffle, comme sacrifiée par les pouvoirs publics.
Ce malaise profond, le nouveau film ne s’en fait pas explicitement l’écho, mais ce contexte très dégradé est une des raisons qui m’ont poussé à le faire. Comme pour en prendre le contre-pied. Pour montrer un lieu qui résiste, qui tente encore de faire une psychiatrie humaine, de rester inventif. De ne pas sombrer.
Et en tournant le film, je comprends mieux à quel point la psychiatrie est un champ auquel je suis si attaché, parce que c’est le miroir grossissant de nos vulnérabilités, de nos fractures, de la violence du monde. Nous voilà face à des personnes qui prennent les choses de plein fouet, quand nous-mêmes nous parvenons à nous protéger un peu, à esquiver les coups.
Vous disiez que la souffrance psychique n’est pas un spectacle. Mais un film, y compris un documentaire, n’a-t-il pas par essence à voir avec le spectacle ?
Quand vous avez une caméra dans les mains, vous êtes en position de force, surtout lorsqu’il s’agit de filmer des personnes vulnérables. En psychiatrie, vous pouvez rencontrer des personnes en pleine crise, très délirantes. De là à transformer leur détresse en spectacle il n’y a qu’un pas, qui peut vite être franchi. Il faut donc y prendre garde. Pour ma part, si les personnes que je filme ne sont pas pleinement là, présentes à ce qui se passe, je préfère m’abstenir. On pourra me reprocher de ne pas montrer les crises, les cris, la violence, mais ça m’est bien égal. Je ne filme personne à son insu. Encore moins à ses dépens.
Vous me répondez en termes éthiques. Mais qu’en est-il du spectacle inhérent au cinéma ?
En effet, vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, filmer, c’est toujours prendre quelque chose à l’autre. Il y a une part de rapt. Et c’est toujours aussi fixer, figer, enfermer celles et ceux que l’on filme dans le temps et dans l’espace. Raison de plus pour ne pas faire n’importe quoi.
Est-ce que les patients résistent davantage au filmage que les soignants ?
Je ne saurais dire. De part et d’autre, il y a des gens que la caméra peut intimider, des gens qu’elle galvanise… Moi, vous savez, je n’insiste jamais. Si une personne ne veut pas être filmée, elle a ses raisons. On ne force pas les gens. En documentaire il faut qu’il y ait un désir partagé. Une confiance. Mon travail consiste à éveiller le désir. Désir d’en être, de jouer le jeu, de donner quelque chose de soi.
En documentaire il faut qu’il y ait un désir partagé. Une confiance.
Sur l’Adamant, quand j’ai commencé, quelques patients ont dit vouloir ne pas être filmés. Quoi de plus normal, on ne se connaissait pas ! Trois jours plus tard, la plupart d’entre eux faisaient machine arrière. Certains ont besoin de temps. D’autres acceptent la caméra spontanément. Je pense à Justin, ce jeune homme qui porte un aimant autour du cou pour se protéger des « ondes » qui l’envahissent. Il a débarqué un jour sur l’Adamant, on ne s’était jamais vus. Deux heures plus tard je le filmais.
L’Adamant n’est-il pas un îlot dans le paysage déliquescent de la psychiatrie ? N’allez-vous pas encourir le reproche d’avoir filmé l’arbre qui cache la forêt ?
C’est un risque, en effet, mais j’assume complètement ! L’Adamant est un lieu très original, qui tranche avec la plupart des lieux de soins psychiatriques, souvent fonctionnels mais sans charme aucun. En lui-même, il est apaisant, presque soignant déjà, grâce à son architecture, très réussie, son emplacement sur la Seine, la proximité de l’eau, les rotondes, le pont, ses baies vitrées, sa grande bibliothèque. De ce point de vue, aucun doute, c’est une exception, mais des lieux où l’on continue à faire une psychiatrie humaine, il y en a bien d’autres, même si c’est de plus en plus tendu, faute de combattants, de moyens humains.
J’entends dire : « L’Adamant est une utopie ! » Mais ce n’est pas tout à fait vrai. Il existe bel et bien. Avec ses difficultés, ses tensions, ses limites. Par ailleurs, je précise, l’Adamant ne requiert pas un financement supérieur aux autres centres de jour des secteurs psychiatriques. Enfin, ce n’est pas un îlot, un lieu replié sur lui-même. C’est tout le contraire. Il fait partie du pôle psychiatrie Paris centre, qui comprend aussi deux centres médico-psychologiques (CMP), une équipe mobile, deux unités hospitalières au sein de l’hôpital Esquirol. Ces structures, reliées les unes aux autres, forment un maillage dans lequel patients et soignants sont appelés à circuler.
Vous disiez que, dans la psychothérapie institutionnelle, c’est l’institution qui tente de s’adapter au patient. Il y en a un bel exemple dans le film, quand une patiente propose d’animer un atelier danse. Ce n’est pas dans les « règles » et pourtant les soignants se proposent d’y réfléchir.
« La frilosité est de notre côté », répond l’un des soignants à Catherine. Sous-entendu : votre proposition nous déstabilise un peu, mais nous allons prendre le temps de l’examiner. Hélas le projet n’a pas été plus loin puisque Catherine est décédée peu après.
La psychothérapie institutionnelle ? Impossible de dire ce que c’est en deux mots. Disons qu’il faut soigner l’institution, lutter contre tout ce qui la menace : la routine, l’ennui, la bureaucratie… Pour être un bon soignant, il faut avoir du désir, être inventif. Sur l’Adamant, comme à La Borde, s’offre une panoplie de possibles : des ateliers, des sorties… On ne sait jamais à l’avance ce qui peut provoquer un déclic, une petite étincelle.
Sans masquer la réalité de la maladie dont sont atteints les patients, vous montrez leur grande lucidité, notamment vis-à-vis de leur souffrance.
Les clichés sont tenaces. Les « fous », j’emploie le mot à dessein, sont presque toujours dépeints comme des gens incohérents, délirants, potentiellement agressifs et dangereux. Or la plupart d’entre eux non seulement sont inoffensifs, mais peuvent avoir des moments de grande lucidité sur les troubles qui les assaillent, une extrême sensibilité, une porosité à tout ce qui se passe.
Dans la presse à sensation, on ne parle d’eux qu’à l’occasion d’un fait divers. Le reste du temps, on ne veut pas les voir. Le film essaie d’estomper ces images, de lutter contre ce cloisonnement, cette stigmatisation. J’aimerais qu’il puisse contribuer à abattre ce rempart trop souvent dressé entre eux et nous. Jusqu’à nouvel ordre, nous faisons partie de la même humanité. Les plus fous ne sont pas toujours ceux qu’on pense.
Comment déterminer la guérison ?
Je ne sais pas dans quelle mesure le mot « guérir » a du sens en psychiatrie. Un schizophrène peut-il guérir ? Vaste question. Ce serait quoi ? Assommer les gens de médicaments pour les « stabiliser » (quelle horreur, ce mot) ? Pour qu’ils se tiennent tranquilles ? Pour pouvoir au plus vite les renvoyer chez eux, faute de lits ? Du reste, ont-ils tous un toit ? Guérir ou soigner ? Il me semble qu’une psychiatrie comme celle qui se pratique dans un lieu comme l’Adamant se refuse à considérer les patients sous le seul prisme de leurs symptômes et reconnaît leur singularité sans chercher à tous crins à la domestiquer.
Un bon soignant, c’est celui qui tentera d’aider le patient à renouer un lien avec le monde.
Je me souviens d’un patient qui, au cours d’une réunion soignants-soignés à l’hôpital, s’est adressé aux psychiatres en demandant : « Qu’attendez-vous de nous ? Qu’on soit comme vous ? » Non, lui a-t-il été répondu. J’ai trouvé cet échange très juste. Il me semble qu’un bon soignant, c’est celui qui tentera d’aider le patient à renouer un lien avec le monde, sans chercher à gommer ce qu’il est. En respectant sa singularité, sa subjectivité. Sa folie.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…
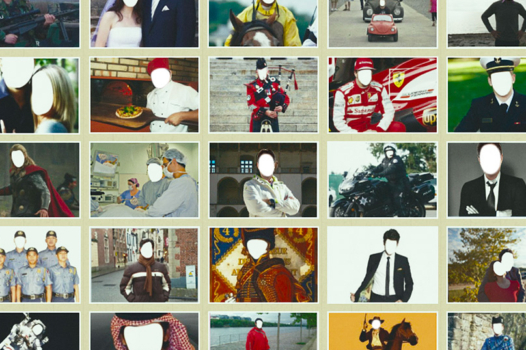
« L’homme aux mille visages » : les traces du mensonge

« Borgo », infernal engrenage

« La Machine à écrire et autres sources de tracas » : réparation générale










