Que peut vraiment le droit face au fascisme ?
Si la montée de l’extrême droite, avec son cortège de haine et de violence, inquiète, l’arsenal légal peut devenir une arme à double tranchant dans la lutte contre les aspirations fascisantes. Exemples.

Manifestations fascistes au cœur de Paris, attentats d’extrême droite déjoués, descente violente de militants après le meurtre du jeune Thomas à Crépol, dans la Drôme, multiplication des groupuscules partout en France : le fascisme s’invite dans les rues et les esprits. Autant d’occasions pour le pouvoir de réagir et la justice d’intervenir.
La République s’est dotée très tôt d’outils pour contrer la menace : au premier chef, la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées, votée en réaction à la manifestation du 6 février 1934 organisée notamment par les ligues d’extrême droite, autorise la dissolution d’organisations par décret. Elle est intégrée au Code de la sécurité intérieure en 2012.
Décidées par le président de la République en conseil des ministres, une centaine de dissolutions ont été prononcées depuis presque un siècle, notamment par le Front populaire et Charles de Gaulle, avant d’être réemployées largement depuis la présidence de François Hollande. La mort de Clément Méric en 2013 la remet à l’ordre du jour : Manuel Valls dissout alors cinq groupes d’extrême droite. Depuis, le Bastion social, Génération identitaire, le Groupe union défense (GUD) ou encore Civitas les ont suivis, parmi près d’une quarantaine d’organisations.
Les motifs de dissolution suivent la loi qui pénalise les discours et actions de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, sans s’y limiter : la volonté d’attenter à la forme républicaine du gouvernement et le terrorisme sont également visés. Depuis 2021, la loi dite « séparatisme » élargit les motifs en intégrant la provocation à « des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » : raison invoquée par Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur, pour dissoudre le Comité action Palestine, le 9 mars 2022, ou encore les Soulèvements de la Terre le 21 juin 2023.
La seconde décision est cependant cassée par le Conseil d’État le 9 novembre 2023, seule instance d’appel en la matière ; ce qui n’a pas été le cas pour les groupes antifascistes de la Gale (Groupe antifasciste Lyon et environs) et du Bloc lorrain, dissous en mars et novembre 2022.
Une telle utilisation contre la gauche est en réalité inscrite dans l’histoire de cette loi, puisque De Gaulle en avait déjà fait un usage massif après 1968 contre les organisations révolutionnaires : le 12 juin 1968, le décret pris par le président dissout onze organisations, dont la Jeunesse communiste révolutionnaire d’Alain Krivine, arrêté puis emprisonné, ou encore l’Organisation communiste internationaliste, qui obtient l’annulation de sa dissolution en 1970.
Au demeurant, l’efficacité des dissolutions est discutée : si elles permettent de casser la dynamique de certains mouvements et conduisent une partie des militants à se détourner de l’action, préfectures et services de police restent sceptiques. De nouvelles organisations apparaissent tandis que le suivi des individus se complexifie, notamment par l’utilisation croissante d’internet et de messageries cryptées au service d’organisations peu structurées.
Défendre la République contre qui ? Et laquelle ?L’interdiction de manifestations, qui relève des préfectures et des mairies, reste également un sujet sensible. Ainsi, plusieurs concerts organisés par l’extrême droite ont pu être interdits, tels le festival Call of Terror en février 2024 ou European Voices, qui devait se tenir le 8 mars 2025. Un colloque et une manifestation organisés par l’Action française en mai 2023 avaient également été
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…
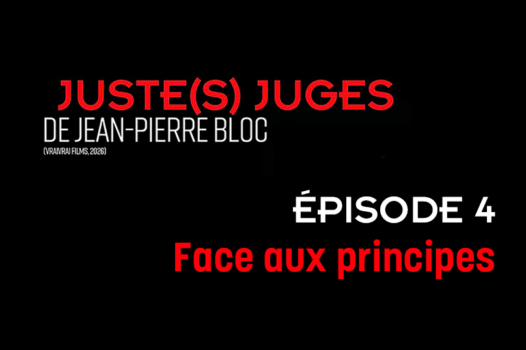
Juste(s) juges – Épisode 4

La criminalisation de l’antifascisme inquiète les soutiens de Zaid et Gino, menacés d’extradition

Extrême droite armée, police peu réactive… Après la mort de Quentin Deranque, des faits et des questions







