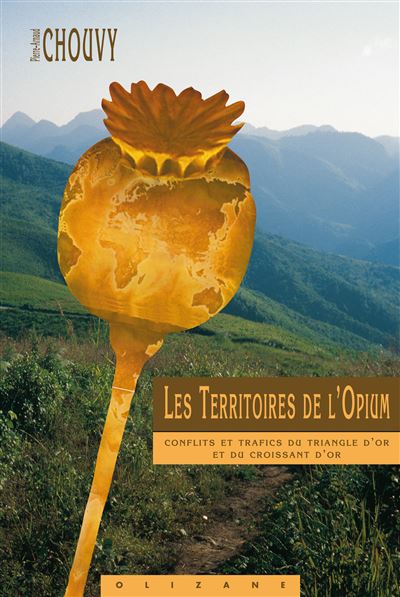Birmanie : dans la solitude des champs de pavot
Plongé dans une guerre civile depuis 2021, le pays est en tête de la production mondiale d’opium, devant l’Afghanistan. À l’Est, dans l’État Shan, la plante est devenue l’une des uniques sources de revenu pour les paysans, et un moyen de financer la guerre pour les groupes rebelles opposés au pouvoir.
dans l’hebdo N° 1864 Acheter ce numéro

© Pierre Terraz
Tous les week-ends, après sa semaine d’école, la petite Nuka travaille 12 heures par jour dans les champs de pavot à opium. La fillette aux cheveux noirs coupés court n’est pas plus grande que les tiges brunes parmi lesquelles elle circule à toute vitesse. On la perdrait de vue si elle ne portait pas une polaire rose décorée de petits lapins.
À la fin de la saison de la récolte, en ce début de mois d’avril, son labeur consiste à arracher les têtes séchées de leur queue pour récupérer des graines marron qui seront replantées l’année prochaine. « J’aide ma famille pour qu’on puisse manger, mais je continue d’aller à l’école au camp de réfugiés la semaine. J’aime les mathématiques », assure la gamine, âgée de 11 ans, en continuant son quadrillage du champ pour n’oublier aucun bulbe.
En Birmanie, la guerre civile a commencé après le coup d’État militaire de 2021 et aurait déjà fait plus 50 000 morts selon des estimations datant de 2024. L’ONU indique que plus de 3,5 millions de personnes ont été déplacées, fuyant vers les régions périphériques contrôlées par les rebelles pro-démocratie, opposés au pouvoir. Comme dans l’État Shan, non loin de la Chine, du Laos et de la Thaïlande, situé au beau milieu du Triangle d’or.
Dans cette vallée montagneuse enclavée, deux silhouettes veillent sur la petite Nuka en lui expliquant les bons gestes. Lin Twee, sa tante, et Lei, une femme plus âgée, portent des moufles en laine usées par le temps et les récoltes successives. Dans cette exploitation, les trois agricultrices sont payées environ 10 euros par jour pour récolter le pavot. Une besogne usante et répétitive : « J’ai mal au dos, aux avant-bras, à la nuque. Mes mains sont sèches, confie Lin Twee en tendant ses paumes craquelées. Je suis épuisée. »
L’échine de cette jeune femme de 36 ans est courbée à l’équerre, des gouttes de sueur perlent à son front. Elle relève le menton toutes les cinq minutes pour vérifier où est la plus jeune des travailleuses. Lorsqu’elle aperçoit Nuka, un sourire soulagé illumine son visage. « La petite travaille bien. Grâce à cela, je peux nourrir décemment mes trois filles et ma nièce. Avant, nous n’avions même plus de riz », grince Lin Twee, en prenant soin d’éviter les engins explosifs qui pullulent sous le sol. La Birmanie est le pays qui dénombre le plus de victimes de mines antipersonnel chaque année, devant la Syrie, l’Afghanistan et l’Ukraine. Dans les champs, les accidents sont fréquents.
J’aimerais cultiver autre chose, mais je n’ai pas le choix.
Lin Twee
En quatre années à fouler ces plaines qui s’étendent à perte de vue, elle a vu évoluer les prix de l’opium. « Je vendais un kilo environ 470 euros l’année dernière, contre 680 euros cette année. On nous achète plus cher car la demande augmente. J’aimerais cultiver autre chose, mais je n’ai pas le choix. » De part et d’autre de l’exploitation, des bâches vertes sont étendues au sol. C’est ici que sont vidés les sacs en osier portés en bandoulière. En haut de l’exploitation, une cabane en bois sommaire abrite le trésor de têtes de pavot.
Une aubaine pour les rebelles
Ces champs étaient autrefois gérés par des organisations criminelles dont les chefs sont mondialement connus, à l’instar de Khun Sa, surnommé le « roi de l’opium » par Interpol dans les années 1980. Avec les bénéfices de la drogue, ces trafiquants ont investi presque tous les secteurs de l’économie du pays : les banques, les compagnies aériennes, les hôtels… En son temps, Khun Sa dirigeait même une milice de plusieurs centaines d’hommes, mise sur pied avec la complicité d’officiels birmans. Il contrôlait alors la quasi-totalité de la production régionale et, en 1994, on estimait que 80 % de l’héroïne distribuée dans les rues de New York venait du Triangle d’or.
Localement, dans les hauts plateaux du pays, des villageois sont toujours accros aux graines de pavot, passant parfois leurs journées entières à tirer sur leurs pipes à opium. Amaigris et sans emploi, ils ont longtemps été stigmatisés par le gouvernement. Pourtant, la consommation de cette plante psychotrope n’est que la partie émergée de l’iceberg.
Outre l’opium, la Birmanie est l’un des premiers producteurs d’amphétamines au monde avec l’ancienne Syrie de Bachar Al-Assad. En 2023, l’armée thaïlandaise a saisi 2 millions de pastilles de cette drogue de synthèse sur sa frontière, et tué quinze trafiquants birmans. Une internationalisation du marché s’est largement accélérée à cause du conflit qui fait rage.
Au loin, les tirs d’artillerie résonnent et viennent interrompre le concert des criquets. Mais Nuka et sa tante continuent leur récolte, imperturbables, en faisant fi des bruits quotidiens de bombardements. À seulement une dizaine de kilomètres de là, les forces gouvernementales tentent de tenir une ville assiégée par les groupes rebelles qui veulent restaurer la démocratie par les armes.
Les champs de pavot se situent à mi-chemin entre la ville de Demoso, « libérée » fin 2023 par les insurgés, et celle de Moe Bye, tenue par la junte. Le putsch militaire du 1er février 2021, qui a propulsé au pouvoir le général autoritaire Min Aung Hlaing, a aussi fait sombrer le pays dans un conflit interne. Aujourd’hui, plusieurs organismes d’observation estiment que moins d’un quart du territoire national serait encore tenu par l’armée.
« Nous manquons d’armes lourdes : mortiers, lance-roquettes, drones… Alors que la junte dispose d’avions de chasse fournis par la Chine et la Russie. Nous luttons avec trop peu face aux attaques aériennes », marmonne le commandant Htet Aung Linn, accroupi dans une tranchée, les yeux rougis par le bétel, un puissant tabac à chiquer. Faute de soutien financier des instances internationales et des démocraties européennes – bien que celles-ci aient condamné le coup d’État de 2021 et l’instauration d’un régime autoritaire –, certains groupes armés pro-démocratie se financent grâce à la vente d’opium à l’étranger.
La drogue rapporte 17 fois plus que la culture du riz, 40 fois plus que celle du blé.
« En Birmanie, les groupes rebelles n’ont pas de moyens de financement extérieur, comme c’était le cas en Afghanistan lorsque la CIA soutenait les moudjahidines contre les Soviétiques. Ils se débrouillent seuls pour financer la lutte armée », précise Pierre-Arnaud Chouvy, chercheur au CNRS, spécialiste de l’économie de cette drogue et auteur du livre Les Territoires de l’opium (2002).
L’opium est donc une aubaine pour les rebelles : 90 % de la production est regroupée dans le seul État Shan, presque totalement contrôlé par des groupes armés. L’absence de police et de toute forme d’État de droit, dans ces zones contrôlées par les insurgés, rend la tâche facile.
Les paysans prisonniers de l’économie de conflit
Pour autant, l’opium ne bénéficie pas à tout le monde de manière égale dans le pays. La drogue rapporte 17 fois plus que la culture du riz, 40 fois plus que celle du blé, mais sa production est aussi bien plus laborieuse et plus coûteuse pour la main-d’œuvre, qui se retrouve dépendante d’un produit extrêmement chronophage à semer et à récolter.
« L’opium est une opportunité économique à double tranchant pour les paysans birmans : ils sont souvent contraints par la crise politique et la guerre à produire de l’opium. Très rentable pour les trafiquants, elle permet à peine aux cultivateurs de ne pas s’endetter, pour un travail bien plus laborieux que celui du riz ou du blé », argumente Pierre-Arnaud Chouvy.
Par ailleurs, le propriétaire d’un terrain indexe toujours le prix de sa parcelle sur celui de la drogue lorsqu’il loue sa terre à un paysan. Dès lors, vu les prix, impossible pour les métayers de cultiver autre chose que du pavot : la production d’opium devient une obligation tacite. Les agriculteurs, qui se mettent à produire de la drogue avant tout pour pallier leur insécurité alimentaire, finissent dépendants de cette économie de conflit.
Les agriculteurs démunis qui cultivent l’opium en Birmanie ne s’enrichissent pas.
Y. Dakowah
Aujourd’hui, la Birmanie produit environ 1 000 tonnes d’opium par an, évalue l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). La plante générerait des revenus estimés entre 589 millions et 1,57 milliard de dollars chaque année. Cependant, « les agriculteurs démunis qui cultivent l’opium en Birmanie ne s’enrichissent pas, ils tentent simplement de gagner leur vie dans des conditions difficiles », précise Yatta Dakowah, directeur de l’ONUDC pour la Birmanie.
Le pays est celui qui compte le plus grand nombre de groupes armés au monde depuis le coup d’État. La Birmanie dénombre à elle seule 2 600 organisations : c’est près de la moitié des milices mondiales. Dans un tel contexte de fragmentation, difficile de mesurer combien rapportent les affaires et les trafics de chacun. Une seule chose est sûre : avec la guerre civile, le trafic d’opium a encore de beaux jours devant lui.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Rome-Tunis-Alger, super gardiens de la forteresse Europe

Au Soudan, le peuple pris au piège de la guerre

Stephen Miller, un suprémaciste à la tête de la sécurité américaine