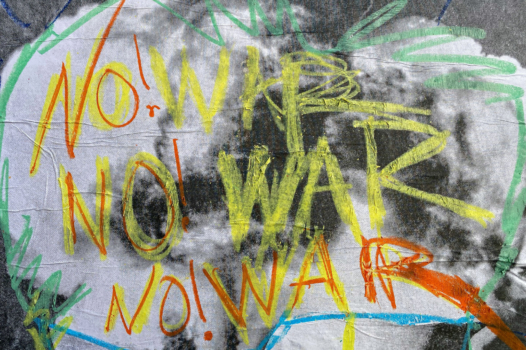Le choc des capitalismes
La mondialisation n’a pas abouti à une convergence vers un modèle uniforme de capitalisme de type occidental.
dans l’hebdo N° 1869 Acheter ce numéro

Le capitalisme s’est imposé sur l’ensemble de la planète. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La chute du mur de Berlin et des régimes communistes en 1989 semblait avoir consacré la victoire du modèle capitaliste occidental, marquant « la fin de l’histoire », selon l’affirmation du politiste états-unien Francis Fukuyama.
L’évolution des capitalismes au début de XXIe siècle a démenti cette prédiction. La mondialisation n’a pas abouti à une convergence vers un modèle uniforme de capitalisme de type occidental. On a assisté au contraire à une importante différenciation des capitalismes, source de tensions internationales de plus en plus vives (1).
Les capitalismes contemporains, Dominique Plihon, La Découverte, coll. « Repères », 2025.
La révolution numérique, la crise financière des années 2010, qui a conduit à une récession mondiale, et la crise du covid-19 ont fait office d’accélérateurs des transformations des capitalismes, donnant un rôle central aux États et conduisant à l’émergence de capitalismes d’État ainsi qu’à des régimes politiques autoritaires, dits « illibéraux », de plus en plus nombreux.
Depuis la fin du XXe siècle, le capitalisme mondial a connu deux changements majeurs qui ont bouleversé la donne géopolitique. En premier lieu, la montée en puissance des pays nouvellement industrialisés, dits émergents, qui se caractérisent par une grande variété, en particulier selon leur insertion dans l’économie mondiale. On peut ainsi opposer le modèle industrialiste du Vietnam et du Mexique au modèle rentier et extractiviste de la Russie et de l’Algérie.
En second lieu, on a assisté à un antagonisme croissant entre les deux superpuissances états-unienne et chinoise. Contrairement aux analyses véhiculées par la plupart des médias, la tension entre ces deux pays, qui s’est exacerbée en cette décennie 2020, n’est pas le fruit du caractère irascible de Donald Trump ou de la folie dictatoriale de Xi Jinping. Elle est le résultat de la rivalité entre ces deux pays et de la montée en puissance spectaculaire de la Chine.
L’avancée de la puissance chinoise est le produit de la mondialisation créée par le capital états-unien.
Il y a un paradoxe important : c’est que l’avancée de la puissance chinoise est le produit de la mondialisation créée par le capital états-unien. Le mot d’ordre MAGA (Make America Great Again) de Trump exprime la volonté désespérée de résister à la Chine et de reconquérir la position hégémonique des États-Unis. Quant à la stratégie de la Chine, elle consiste à contester la domination états-unienne en tirant le meilleur parti possible du capitalisme mondialisé mis en place par Washington.
Autre élément paradoxal : ces deux capitalismes, que tout semble opposer, convergent en fait aujourd’hui sur deux points essentiels : ce sont des capitalismes numériques et autoritaires, qui assoient leur pouvoir, à l’intérieur et à l’extérieur de leurs frontières, sur la technologie numérique et la remise en cause de l’État de droit.
Chaque semaine, nous donnons la parole à des économistes hétérodoxes dont nous partageons les constats… et les combats. Parce que, croyez-le ou non, d’autres politiques économiques sont possibles.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Libre-échange : sinistre Saint-Valentin indo-européenne

L’Allemagne et la règle d’or

Le modèle extractiviste vénézuélien, tout sauf une référence