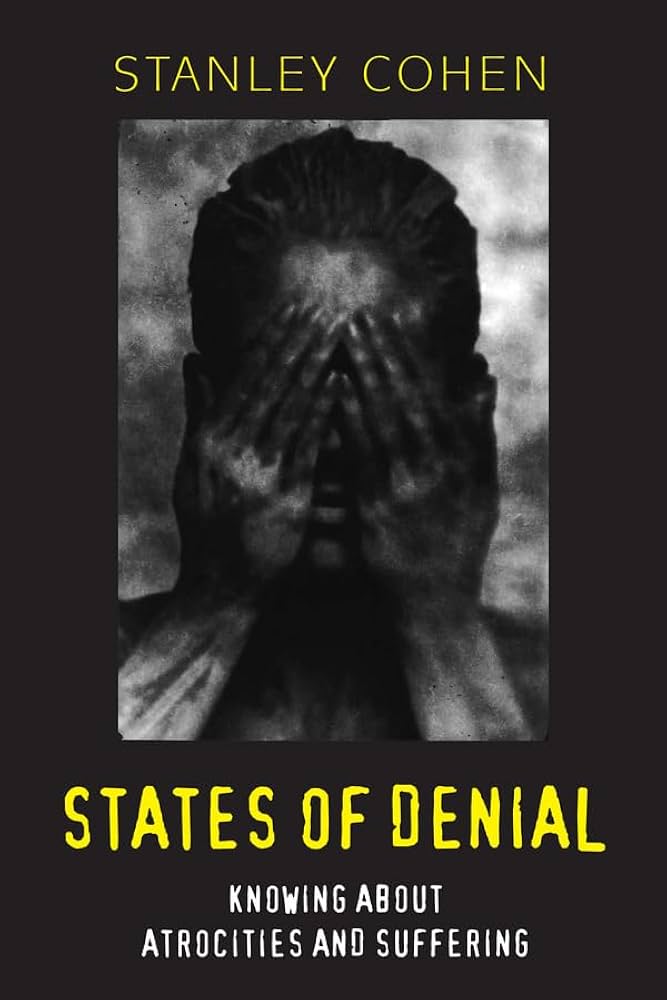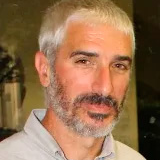Gaza : comment le déni s’est imposé dans la société israélienne
Dans le média en ligne israélo-palestinien +972 Magazine, le sociologue Ron Dudai décortique la rhétorique de nombreux Israéliens face à la documentation, en temps réel, des massacres et de la famine subis par les Gazaouis. Les réactions oscillent entre « tout est faux » et « c’est mérité ».
dans l’hebdo N° 1883 Acheter ce numéro

© MOIZ SALHI / Anadolu / AFP
Dans le même dossier…
« Avec mon cinéma, je sais provoquer de la peine et de la douleur chez les Israéliens » Après deux ans de génocide, où va Israël ? « Il n’y a pas une mais plusieurs sociétés israéliennes » « À Tel-Aviv, une demande de fin de guerre se fait peu à peu entendre »En partenariat avec +972 Magazine.
Il y a dix ans, lors des dernières manifestations hebdomadaires réunissant juifs et Palestiniens contre la construction du mur de séparation par Israël dans le village cisjordanien d’Al-Maasara, l’un de nos rituels, avant de démarrer, consistait en un discours de Mahmoud, un leader communautaire local. Téléphone en main, celui-ci déclarait : « Nous n’aurons pas d’autre Nakba, parce que maintenant nous avons ceci. Nous avons un smartphone. Nous avons Facebook. En 1948, nous n’avions ni l’un ni l’autre. Cela ne peut plus arriver aujourd’hui. » Il répétait ce mantra chaque vendredi – aux militants, aux soldats, à lui-même. C’était rassurant. Mais il avait tort.
Le déni d’atrocités est un phénomène universel, mais la société israélienne en a fait une sorte d’art.
La campagne génocidaire menée aujourd’hui par Israël à Gaza est peut-être l’atrocité la plus documentée de l’histoire récente. Les smartphones et les réseaux sociaux, encore inexistants lors des génocides en Bosnie et au Rwanda, permettent de capturer les événements instantanément, de les diffuser mondialement en temps réel. Pourtant, face au flot d’images de civils morts, d’enfants affamés et de quartiers rasés, une grande partie du public israélien – et beaucoup de ses soutiens à l’étranger – réagit de deux façons : soit tout est faux, soit les Gazaouis l’ont mérité. Souvent, paradoxalement, ce sont les deux à la fois : « Il n’y a pas d’enfants morts à Gaza, et on a bien fait de les tuer. »
Le déni d’atrocités est un phénomène universel, mais la société israélienne en a fait une sorte d’art. Ce n’est pas un hasard si l’un des ouvrages les plus importants sur le sujet, States of Denial (2001), du sociologue Stanley Cohen, s’inspire des années de l’auteur comme militant des droits humains en Israël pendant la première Intifada. Il y décrit un répertoire de déni : « Ce n’est pas arrivé » (nous n’avons torturé personne) ; « C’est autre chose qui s’est passé » (ce n’était pas de la torture mais une « pression modérée ») ; « il n’y avait pas d’alternative » (la « bombe à retardement » la rendait nécessaire).
En Israël, cette logique repose sur deux piliers : le mythe de la « pureté des armes » (Israël n’agit que par légitime défense) et la culture du « tirer et pleurer » (nous faisons ce qu’il faut, mais en éprouvant du remords). Aussi hypocrites soient-ils, ces mythes présupposent que certaines actions sont moralement répréhensibles et que leur révélation est problématique. Dans ce cadre, documenter une atrocité pouvait avoir un impact : créer un malaise, déclencher une pression. Mais ce temps-là est révolu.
Depuis le début de la guerre à Gaza, il est devenu courant d’entendre que tout est fabriqué.
Aujourd’hui, l’instinct poussant à rejeter toute information venue de Gaza comme « fausse » est devenu dominant en Israël, du sommet de l’État aux commentateurs anonymes sur les sites d’info. Cette mentalité complotiste vient des droites américaines, tout comme la rhétorique trumpienne du « deep state », très utilisée par Benyamin Netanyahou et ses alliés. L’un des modèles de ce style de déni est Alex Jones, figure de l’extrême droite états-unienne qui, en 2012, affirma que la fusillade de Sandy Hook, durant laquelle 20 enfants et 6 adultes furent tués, avait été mise en scène – en dépit de toutes les preuves.
Post-vérité, post-honte
Cette rhétorique a gagné Israël bien avant le 7-Octobre. D’abord en ligne, puis dans les discours officiels. Depuis le début de la guerre à Gaza, il est devenu courant d’entendre que tout est fabriqué : un nourrisson mort ? « Une poupée. » Des civils tués ? « Images générées par l’IA. » Cette réaction, associée au terme « Pallywood » – contraction de « Palestinian » et « Hollywood » –, suggère que les Palestiniens, aidés par les ONG et les médias, orchestrent des mises en scène.
Dans les années 2000, il fallait encore déployer des efforts pour nier.
Dans les années 2000, il fallait encore déployer des efforts pour nier : on se souvient du cas de Muhammad al-Durrah, tué à Gaza en 2000. Les Israéliens et leurs partisans ont passé des centaines d’heures à tenter de démontrer que la scène avait été truquée. Aujourd’hui, il suffit d’un mot : « Faux. » C’est ce que les chercheurs appellent le conspiracisme : non plus des théories du complot structurées, mais un rejet systématique de toute preuve gênante.
Prenons la famine à Gaza : après des mois de siège, de destructions agricoles, d’entraves à l’aide humanitaire, la famine s’est installée. Pourtant, nombre de responsables israéliens persistent : « Tout est faux. » Netanyahou a évoqué une « perception d’une crise humanitaire » créée par « des images manipulées » diffusées par le Hamas. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a dénoncé une « réalité virtuelle », arguant que les enfants affamés étaient entourés d’adultes bien nourris. L’armée israélienne a prétendu que certaines images venaient du Yémen ou avaient été générées par l’IA.
Même des journalistes critiques ont relayé ces arguments. Un article d’Ynet a affirmé : « Les Palestiniens savent que les photos d’enfants affamés sont un point sensible. Les images sont probablement mises en scène. » Ce type de déni a aussi gagné les milieux universitaires. Un rapport du Centre Begin-Sadat, à l’université Bar-Ilan, voué à réfuter les accusations de génocide, contenait une section sur les « sources fausses ou générées par l’IA ».
Aujourd’hui, la situation est différente des précédents cycles de violence. Nous vivons dans une ère de post-vérité, marquée par une méfiance généralisée envers les médias, une peur de la manipulation par l’intelligence artificielle et un affaiblissement des contre-pouvoirs démocratiques. Dans ce contexte, l’accusation de « faux » est plus facile et puissante que jamais.
Il n’y a pas de famine à Gaza.
A. Eliyahu
Et comme les médias israéliens montrent peu ou pas les souffrances à Gaza, lorsqu’une image filtre, la réaction est souvent un haussement d’épaules, accompagné du classique : « Ils l’ont bien cherché. » Le déni et la justification s’entremêlent. Le ministre du Patrimoine, Amichai Eliyahu, a récemment déclaré : « Il n’y a pas de famine à Gaza. Quand on vous montre des enfants affamés, regardez bien : il y a toujours un enfant qui mange bien à côté d’eux. » Et d’ajouter : « Aucune nation ne nourrit ses ennemis. Le jour où ils rendront les otages, il n’y aura plus de faim. »
Le 7-Octobre a confronté les Israéliens à une réalité qu’ils avaient passé deux décennies à refouler. Gaza, que l’on voulait invisible, est revenue au premier plan. C’est alors que les deux réflexes – « faux » et « mérité » – se sont cristallisés. Le premier protège l’image d’Israël – « Nos soldats ne tuent pas d’enfants. » Le second canalise la rage et l’humiliation d’avoir été attaqués par ceux que l’on considérait comme inférieurs. C’est là que réside le second défi majeur posé à la croyance selon laquelle les smartphones et les réseaux sociaux empêcheraient les atrocités. Les défenseurs des droits humains ont longtemps cru que documenter les crimes provoquerait un sursaut de conscience.
Début de honte
Mais que se passe-t-il quand les auteurs n’éprouvent plus de honte ? Quand ils méprisent ouvertement la morale et l’idée même de vérité ? Documenter, alors, n’a plus le même pouvoir. Et, paradoxalement, les dirigeants israéliens ne se cachent même plus. Ces deux dernières années, rapports d’ONG et plaintes internationales ont montré que les chefs militaires, politiques et culturels assumaient ce que les ONG peinaient autrefois à démontrer.
Là où le mot « Nakba » était autrefois censuré en Israël, il est aujourd’hui revendiqué fièrement : « Nous menons une seconde Nakba à Gaza. » Alors que les militants de B’Tselem se mettaient en danger pour filmer les exactions en Cisjordanie, aujourd’hui ce sont les soldats eux-mêmes qui diffusent leurs crimes sur les réseaux sociaux. Le cycle habituel – exposition, déni, confirmation – s’effondre.
Alors, à quoi servent encore les smartphones et les vidéos ? Peut-être à quelque chose tout de même. Car il semble que les réflexes « faux » et « mérité » atteignent leurs limites. Devant l’évidence de la famine à Gaza, les dénégations deviennent plus fébriles. Répéter qu’un enfant mort souffrait déjà d’une maladie n’a pas empêché certains Israéliens de reconnaître, parfois, que quelque chose cloche. Les contorsions rhétoriques actuelles – « Ce n’est pas notre faute, c’est le Hamas », « Ce n’est pas intentionnel », « Et le Yémen alors ? » – relèvent toutes du déni tel que le décrivait Stanley Cohen. Mais elles laissent aussi entrevoir un malaise, voire un début de honte.
Ce basculement naît sans doute de la pression internationale, mais aussi d’un mécanisme psychologique : reconnaître la famine sans accuser directement les soldats. La documentation a contribué à cette prise de conscience. Mais, alors qu’Israël envisage d’occuper Gaza City et de déplacer ses habitants vers des zones pouvant ressembler à des camps de concentration, le danger d’une aggravation dramatique est réel. La population israélienne cédera-t-elle encore au déni ? Ou sera-t-elle forcée d’affronter la réalité ?
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

« Contre l’impérialisme, les aspirations décoloniales imaginent une autre Russie »

Narva, Estonie : dernier arrêt avant Moscou

Leïla Shahid, une vie palestinienne