Au Chili, sur l’île de Robinson Crusoé, comment la pêche est restée durable
Perdu au milieu du Pacifique à 670 kilomètres des côtes chiliennes, l’archipel mondialement connu pour avoir inspiré le célèbre roman de Daniel Defoe est aussi un bijou de biodiversité marine que ses habitants ont su conserver depuis plus d’un siècle. Au contraire des ressources terrestres, qui se trouvent dans un état alarmant.
dans l’hebdo N° 1889 Acheter ce numéro

Il est 5 h 30 du matin sur l’île Robinson Crusoé, et le village de San Juan Bautista, tapi dans une petite vallée desservie uniquement par bateau, est encore endormi. Sur le pont, les pêcheurs sont déjà prêts à embarquer pour une longue journée de pêche. Hector et ses deux compères, Ramón et Patricio, mettent le cap sur l’île de Santa Clara, qui forme l’archipel de Juan Fernández avec les îlots Robinson Crusoé et Alejandro Selkirk. Ce dernier était un marin écossais arrivé sur l’île en 1704 avec une expédition européenne. « Il n’arrêtait pas de se plaindre que le bateau était en mauvais état, raconte l’historien Fernando Venegas. L’équipage a décidé de le laisser sur l’île. »
Selkirk a vécu isolé sur ces terres inhabitées entre 1704 et 1709, avant qu’une expédition anglaise n’accoste et le ramène en Angleterre. Racontée sur le Vieux Continent, son histoire aurait inspiré Daniel Defoe pour écrire Les Incroyables Aventures de Robinson Crusoé. Et c’est en 1966, à la demande d’une habitante uruguayenne de l’île qui voulait attirer les touristes, que le gouvernement chilien accepte de renommer ces deux îles alors appelées Más a Tierra (plus proche de la Terre) et Más Afuera (plus éloignée).
L’île Robinson Crusoé abrite aujourd’hui le seul village de l’archipel où vivent toute l’année quelque 1 200 habitants. « Nous avons tous une relation particulière avec la mer et nous pêchons depuis le plus jeune âge », raconte Hector, le capitaine de l’embarcation, caché derrière ses lunettes noires et sa casquette.
Nous avons tous une relation particulière avec la mer et nous pêchons depuis le plus jeune âge.
HectorAprès une heure et demie de navigation à bord d’un petit bateau de pêche artisanal, Ramón coupe quelques morceaux de maquereau royal (sierra) que son collègue Patricio accroche à une vingtaine d’hameçons répartis sur une longue corde lestée par une pierre. « Nous ne pêchons qu’avec des techniques artisanales », explique Patricio, qui ajoute qu’aujourd’hui ils vont utiliser la technique de la palangre pour attraper la breca ou le bacalao (morue), et la canne à pêche pour la vidriola.
Pour la langouste ou le poulpe, les pêcheurs de Robinson Crusoé utilisent des pièges en bois qu’ils fabriquent eux-mêmes. « La langouste est le produit
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »
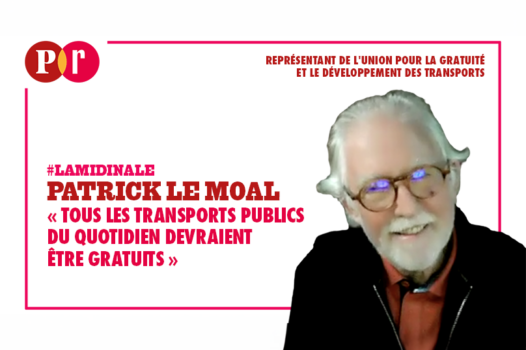
« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »

La pollution, un impensé colonialiste







