Patrick Autréaux : « Au cœur de l’écriture, il y a : “je ne sais pas” »
Avec Quand la parole attend la nuit, Patrick Autréaux livre un puissant roman d’initiation en suivant l’évolution d’un étudiant en médecine dont l’élan vers les autres passe par une meilleure compréhension de lui-même.
dans l’hebdo N° 1571 Acheter ce numéro
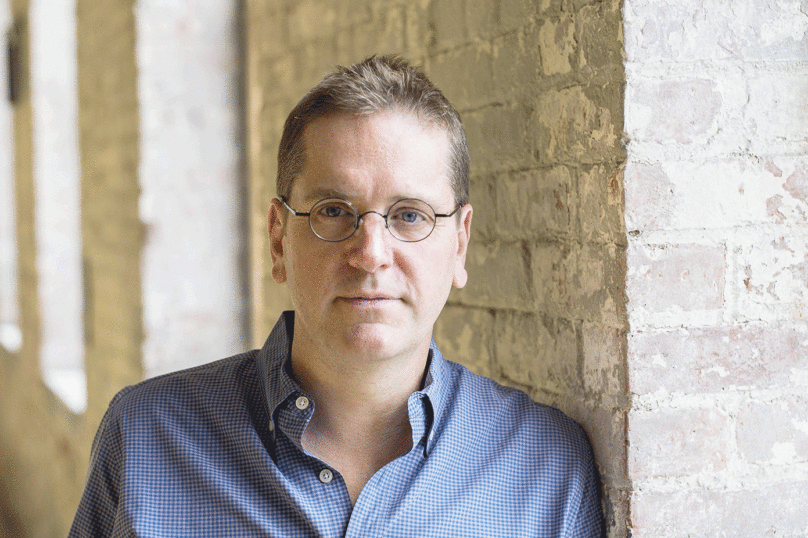
Faire médecine. Voilà une injonction courante dans nombre de familles ou certains milieux sociaux, intégrée par quantité de fils et de filles. Tel n’est pas du tout Solal, le personnage du roman de Patrick Autréaux Quand la parole attend la nuit. Le fait qu’il ait entrepris des études de médecine répond pourtant à un appel ancré en lui très tôt, en raison d’anciens deuils familiaux et d’une mère qui a survécu enfant à une maladie grave : il s’agit de faire des miracles.
Quand le livre commence, Solal est un idéaliste, enclin à la contemplation, auteur de poèmes, connaissant sa première passion amoureuse homosexuelle. Mais « les études de médecine, en général, ne sont guère que des initiations de pacotille », écrit Patrick Autréaux, qui parle d’expérience, ayant lui-même été psychiatre urgentiste pendant des années. Les études de médecine sont difficiles, non seulement par le haut niveau de savoir et de technicité exigé, mais parce qu’elles requièrent un travail sur soi, une maturité, alors qu’on est encore dans l’inquiétude de la jeunesse, afin de mieux être à l’écoute des autres.
Quand la parole attend la nuit raconte ce parcours, qui passe, pour Solal, par des bouleversements dans sa vie amoureuse et sexuelle, des remises en question dans sa vie spirituelle et d’intenses rencontres dans sa vie à l’hôpital. Ce livre, dont l’action se déroule entre la chute du mur de Berlin et le 11 septembre 2001, est un roman d’apprentissage, de tous les apprentissages. C’est pourquoi il semble sans cesse s’élargir, mettant progressivement l’intimité de Solal en correspondance avec le monde, cette humanité qui peuple les hôpitaux, de laquelle, en vérité, nous faisons tous partie.
Plusieurs des ouvrages précédents de Patrick Autréaux étaient issus de l’onde de choc de la maladie qui l’a touché et aurait pu le tuer. Ces livres cherchaient une lumière au cœur de la déréliction. Situé dans la période de sa vie qui précède, Quand la parole attend la nuit en constitue l’archéologie. On y retrouve la même faculté de pénétration de l’insaisissable.
En quoi l’apprentissage de la médecine est-il un mode de connaissance de soi et des autres ?
Patrick Autréaux : Telle était la piste de départ pour ce livre : étudier la médecine dépasse le seul but du soin. C’est explorer la multitude en soi, découvrir dans les autres les multiples facettes qu’on peut reconnaître. Et ainsi mieux comprendre ce qui peut paraître incompréhensible chez autrui. « L’homme normal ne sait pas que tout est possible » : cette phrase est au cœur de ce roman, je n’en ai pas précisé la référence, elle est extraite de L’Univers concentrationnaire, de David Rousset. Lorsque je l’ai lue autrefois, je l’ai immédiatement transposée à mon expérience des urgences psychiatriques. Et puis mon histoire familiale ne me rendait pas étranger à la violence de la « folie ». Si l’on est suffisamment attentif à ces petits écarts que l’on peut tous sentir en soi, que la vie quotidienne masque et que les crises rendent manifestes, si on ne les nie pas, on peut regarder l’autre avec moins de distance, on biaise notre tendance à juger.
Un jour – j’étais déjà praticien – j’ai reçu un vieil homme mélancolique qui présentait les symptômes de ce qu’on appelait au Moyen Âge l’acédie : c’était un grand croyant qui avait perdu la foi. Alcoolique et très revêche. À un moment donné, vouant aux gémonies tous les psys, il cite un vers. Je rétorque : « Jean de La Croix ! » Son regard change alors, une accroche se fait ; lui sur un brancard, moi dans ma blouse, nous nous mettons à parler de poésie. Ainsi, lui qui avait toujours été opposé à une hospitalisation, il en a accepté l’idée, ce qui a immensément soulagé sa femme, désemparée. Cette rencontre m’a marqué, parce qu’a posteriori j’ai réalisé que j’aurais pu être cet homme. À ce moment-là, je n’avais encore presque rien publié, j’avais du mal à trouver ma voix. Si je n’étais pas parvenu à une écriture qui accueille pour moi une forme de sacré (dont j’ai une conception indépendante de toute transcendance), j’aurais pu être lui.
Solal, le personnage de Quand la parole attend la nuit, fait des rencontres qui le renvoient à lui-même, à sa famille ou à des situations douloureuses qu’il a enfouies. De sorte que la fameuse distance thérapeutique, dont la nécessité nous est martelée pendant nos études, à juste titre, mais qui entraîne souvent un clivage entre médecins et patients, Solal se rend compte qu’il la rend poreuse grâce à sa propre histoire.
Une fois que vous avez été médecin, le fait d’avoir été malade vous-même vous a fait passer de l’autre côté de la « barrière »…
En effet, et je n’aurais pu écrire ce livre si je n’avais pas été malade. Passer de « l’autre côté » (même si je n’aime pas cette expression) m’a fait prendre conscience qu’il n’y a pas une séparation si nette entre maladie et bonne santé. En raison des progrès thérapeutiques, la frontière est aujourd’hui plus floue, que ce soit en soi-même ou dans le regard de l’autre, si tant est que l’autre délaisse ses préjugés et sa peur (la grande affaire !). L’usage des trithérapies en est l’exemple le plus flagrant. Mais, au fond, on peut dire cela de nombre d’affections chroniques : épilepsie, diabète ou cancer. Dans beaucoup de cas, on se trouve dans un entre-deux. Et pour ce qui me concerne, je vis dans cet entre-deux. Peut-être que la vraie vie, c’est d’être un survivant.
Quand la parole attend la nuit est fondé sur votre expérience et votre biographie. En quoi est-ce un roman ?
Après mon récit La Voix écrite (1), qui bouclait un cycle, j’ignorais dans quelle direction aller pour le prochain. Au bout de deux ans, ayant accumulé notes et esquisses, je me suis retrouvé devant deux livres possibles. L’un explicitement autobiographique, comme je savais faire. Et un autre dont la manière était floue et qui, pour cette raison, m’intéressait davantage. C’est la matérialisation en moi d’une silhouette avec un prénom, Solal, une sorte de double, qui m’a engagé dans le récit. J’ai su dès lors que ce livre que je ne savais pas faire était un roman. Je me sentais comme un marionnettiste greffé de ce prolongement qu’est la marionnette. Et celle-ci est à la fois une projection et un être autonome.
J’ai voulu retrouver l’errance et l’inquiétude qui ont été les miennes avant ce choc existentiel que peut provoquer une annonce de mort, sur quoi j’ai beaucoup écrit. Or la voix narratrice ne pouvait pas, sans posture, utiliser le « je » d’avant, celui que la maladie a métamorphosé. Il me fallait un « il » (ç’aurait pu être un « tu ») et un écart fictionnel.
À propos du clivage entre médecins et patients, quand vous étiez étudiant, qu’est-ce qui vous a particulièrement heurté dans l’attitude des premiers ?
Je me souviens surtout de propos de « vieux » internes et de chefs de clinique, entre raideur, cynisme et bravade, quand le patient est pris pour un objet. Ces mots me heurtaient, même si je sais bien qu’ils étaient en général le signe d’une défense contre la violence qu’est l’apprentissage médical. J’étais choqué notamment par la manière dont les malades du sida – c’était avant l’arrivée des trithérapies et ils étaient condamnés – étaient traités par certains patrons. Des « malades pas faciles », entendait-on fréquemment. Évidemment, mon trouble était aussi lié à l’écho que ça portait dans ma vie intime. J’avais parfois leur âge. J’ai voulu inscrire ça également en Solal.
Le fait d’être homosexuel, c’est-à-dire d’appartenir à une minorité stigmatisée, aide-t-il le jeune Solal à gagner en maturité et à être un étudiant en médecine attentif aux autres ?
La maturité d’un soignant n’est pas acquise d’emblée, elle se façonne. Solal est un idéaliste un peu sentimental qui, au contact de l’institution, perd ses illusions et sa naïveté – ce en quoi il est représentatif de nombre de soignants non issus de famille de médecins. Je ne veux pas sous-entendre que, parce qu’on est un « homme blanc hétérosexuel », on ne peut pas avoir une histoire singulière qui rende perméable aux petits accrocs, aux apparentes bizarreries. Mais ce qui me semble évident, c’est qu’un décalage avec la « norme », quelle qu’en soit la cause, ouvre très tôt les oreilles. Non pas pour tout comprendre, mais pour devenir plus attentif à ce qui se dit et à comment ça se dit. À ce qui parle sans les mots ou sous les mots. Et n’est-ce pas un des enjeux de la littérature ?
J’ai été un clinicien passionné : j’aimais repérer les signes, établir des syndromes, faire des diagnostics. Un corps ne se livre pas comme ça, par un simple « aïe », c’est un frémissement sur la peau, une infime crispation musculaire… Les textes qu’on écrit et qu’on lit, non plus. Il faut être un peu « fêlé » (et se laisser fêler) pour bien lire !
Pourquoi avoir ouvert le livre sur une histoire d’amour, ou plus exactement une passion amoureuse ?
De l’empathie à l’amour, il y a un continuum. Avant que Solal m’apparaisse, je savais que l’amour constituerait l’une des dimensions du livre. Partiellement fidèle au roman d’apprentissage (cf. Goethe), je suis allé d’une histoire passionnelle, au fond assez banale, à la rencontre qui clôt le livre. Mais en restant tendu par l’idée simple que se comprendre soi-même, comprendre ses parents et mieux comprendre les autres aide à aimer – et qu’aimer est possible ! J’ai peut-être ouvert le roman ainsi parce qu’une passion malheureuse fait éprouver le morcellement de soi (la déliaison), l’émergence mélancolique de la pulsion de mort. La passion amoureuse, c’est la racine du mal (rires), et rien de tel que le mal pour écrire !
Toutefois, ce début ne m’est apparu logique qu’a posteriori. En écrivant, je suis mes intuitions. Beaucoup de choses vous échappent. On ne comprend à peu près un livre que lorsqu’on l’a écrit. À une étudiante qui m’interrogeait un jour sur ce qu’est l’écriture, je me suis entendu répondre : « Je ne sais pas. Au cœur de l’écriture, il y a : “je ne sais pas”. »
Le livre développe aussi une critique matérialiste sur le quotidien d’un hôpital, les économies qui y sont faites, les conséquences désastreuses des politiques de santé…
J’étais étudiant à la fin des années 1980 et dans les années 1990, c’est-à-dire à une époque d’accélération du démantèlement de l’hôpital public. La situation actuelle extrêmement critique est en germe depuis longtemps. Dès le début de mes études, on nous a répété que nous ne serions jamais au chômage. Parce que tout le monde savait que quinze ans plus tard, alors que nous serions en pleine activité, la démographie médicale s’effondrerait. Les politiques au pouvoir (tous bords confondus) n’ont pas pour autant renoncé à l’idée selon laquelle en diminuant le nombre de médecins, on diminue le nombre d’actes. Idée stupide, voire pire… Or mes personnages ne sont pas coupés des réalités économiques et politiques. Dans la mesure où je les inscris dans une réalité institutionnelle, certes composite mais assez réaliste, je ne vois pas pourquoi, sans tomber non plus dans le reportage, je négligerais ces aspects-là.
Quand la parole attend la nuit, Patrick Autréaux, Verdier, 176 pages, 15 euros.
(1) Lire Politis du 18 janvier 2017.
Pour aller plus loin…

« L’homme aux mille visages » : les traces du mensonge

« Camille s’en va » : de l’activisme écologique

« Baumgartner », ou le deuil impossible








