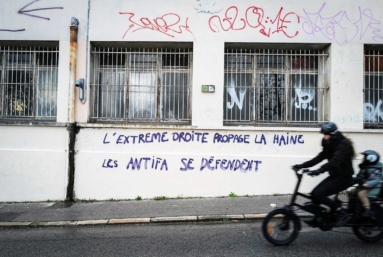Coup de jeune à la CGT
La « bataille des retraites » a redoré le blason des syndicats, suscitant des adhésions dans la nouvelle génération. Un sang neuf sur lequel compte bien s’appuyer, pour l’avenir, la confédération désormais dirigée par Sophie Binet.
dans l’hebdo N° 1788-1791 Acheter ce numéro

© Maxime Sirvins
D’un sexagénaire moustachu à une femme – la première de l’histoire ! – de 41 ans. Le passage de relais entre Philippe Martinez et Sophie Binet à la tête de la CGT illustre, à lui seul, le coup de jeune qu’a pris le deuxième plus important syndicat du pays. Outre ce turnover, s’est déroulé à l’hiver et au printemps dernier le plus grand mouvement social du XXIe siècle. La mobilisation contre la réforme des retraites a mis au centre du jeu des syndicats soudés et combatifs. « Durant ce mouvement, on a eu une intersyndicale crédible et légitime dans l’espace public », notait par exemple le sociologue Karel Yon dans nos colonnes début octobre.
Une crédibilité qui a redoré le blason d’organisations marginalisées par le pouvoir en place ; une légitimité qui a poussé des dizaines de milliers de travailleurs à rejoindre leurs rangs. À la CGT, on estime que plus de 40 000 personnes ont pris leur carte grâce à la bataille des retraites. Et parmi elles, de nombreux jeunes. « Nous n’avons pas encore quantifié précisément la part des moins de 30 ans dans cette masse d’adhérents, mais on peut déjà
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

La criminalisation de l’antifascisme inquiète les soutiens de Zaid et Gino, menacés d’extradition
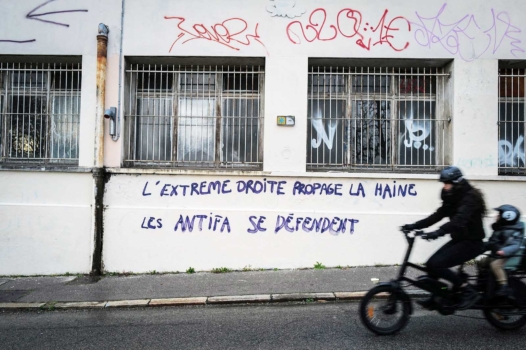
« Les groupes antifascistes se sont toujours constitués en réaction à la violence de l’extrême droite »

La révolution sera paysanne