Zyed et Bouna, 20 ans après
Depuis le décès des deux adolescents à Clichy-sous-Bois en 2005 et les révoltes qui ont suivi, les différents gouvernements n’ont cessé d’accroître le dispositif sécuritaire à chaque nouvelle tragédie. Le dialogue, lui,
a été enterré depuis longtemps.
dans l’hebdo N° 1885 Acheter ce numéro
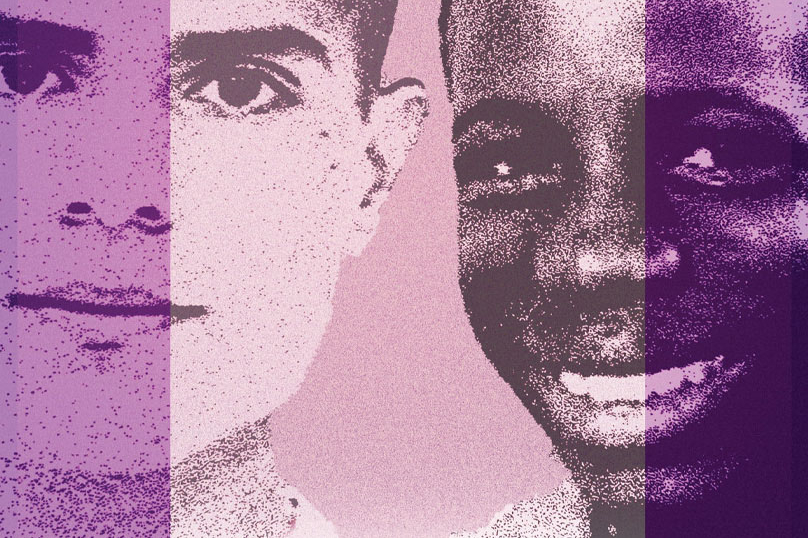
Vingt ans ont passé depuis ce soir du 27 octobre 2005 où Zyed Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, sont morts à Clichy-sous-Bois. Un troisième adolescent, Muhittin Altun, 17 ans, a été gravement brûlé. Il était resté près de sept semaines à l’hôpital, dont six en isolement dans une chambre stérile. Les trois mineurs avaient fui une patrouille de police et, paniqués, s’étaient réfugiés dans un transformateur électrique.
Cette nuit-là, et pendant trois semaines, la France a vu s’embraser d’abord Clichy-sous-Bois puis des centaines de communes, dans une vague de révoltes sociales que l’on s’est empressé de qualifier de « violences urbaines » ou « d’émeutes » pour mieux éviter d’en regarder les causes. À Clichy-sous-Bois, l’enclavement urbain, le manque d’équipements, le chômage des jeunes et des relations dégradées avec la police forment un terreau. En 2005, la ville compte un taux de chômage de 25 % et la moitié de la population à moins de 25 ans.
Mehdi Bigaderne, aujourd’hui adjoint à la maire de Clichy-sous-Bois et membre fondateur d’ACLefeu (pour Association collectif liberté, égalité, fraternité, ensemble, unis), se souvient. « La mort de Bouna, je l’ai vécue viscéralement. Le lendemain, je découvre la ville comme je ne l’avais jamais vue, avec des carcasses de voitures, des débris, des poubelles. » Dans les jours qui suivent, la colère s’amplifie, nourrie par un sentiment d’injustice.
Le 30 octobre, une grenade lacrymogène explose aux abords de la mosquée Bilal, de Clichy-sous-Bois, en pleine prière du ramadan. L’événement agit comme un tremplin de la contestation, même si l’enquête établira que la police n’a pas « visé » directement la mosquée. Très vite aussi, les autorités ont adopté une lecture strictement sécuritaire des événements, jusqu’au décret d’un état d’urgence à partir du 8 novembre 2005, en mobilisant une loi inutilisée depuis 1955 et héritée de la guerre d’Algérie. Pour Mehdi Bigaderne, « c’est une réponse néocoloniale alors que ce sont des enfants français ».
Le couvre-feu instauré dans plusieurs communes, la suspension des libertés de circulation ou de réunion et l’arsenal policier déployé installent le cadre d’une réponse vue uniquement via le prisme de l’ordre. Le 7 novembre 2005, le premier ministre, Dominique de Villepin, déclare que « la priorité, c’est le rétablissement de l’ordre public ». Avant 2005, les banlieues avaient déjà connu des révoltes, notamment en 1990 à Vaulx-en-Velin après la mort de Thomas Claudio, ce qui mena à la création du ministère de la Ville, puis en 1998 à Toulouse et en 2000 à Combs-la-Ville, après la mort de jeunes tués par la police.
On a voulu donner une autre lecture au débat, dénoncer ces “spécialistes” qui disaient que les révoltes étaient la faute du rap ou de l’immigration.
M. BigaderneFace au silence officiel et au discours niant toute responsabilité policière, une génération se mobilise. « On a voulu donner une autre lecture au débat, dénoncer ces “spécialistes” qui disaient que les révoltes étaient la faute du rap ou de l’immigration. On voulait redonner la parole aux habitants. » Ainsi naît ACLefeu, collectif citoyen fondé à Clichy-sous-Bois. En 2006, ses membres parcourent la France pour recueillir des milliers de doléances et remettre le « cahier » qui les contient à l’Assemblée nationale : on peut y lire « tout le mépris que les institutions avaient envers les jeunes des quartiers ».
L’ordre avant toutPendant ce temps, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, multiplie les déclarations provocatrices. En juin 2005, à La Courneuve, il promettait déjà de « nettoyer les cités au Kärcher », et le 26 octobre 2005, à Argenteuil, la veille de la tragédie, il lançait à des habitants du quartier du Val-d’Argent : « Vous en avez assez de cette bande de racailles ? On va vous en débarrasser. » La police de proximité a disparu en 2003, cinq ans seulement après son déploiement.
Rassemblement en hommage à Nahel Merzouk, à Nanterre, en juin 2024. (Photo : Maxime Sirvins.)« Des patrouilles conviviales et sympathiques à 9 heures du matin, c’est bien, mais ça ne sert à rien », justifiait alors Nicolas Sarkozy. Résultat : une défiance mutuelle, renforcée par des discriminations systémiques. « On a affaire à des policiers qui ne sont pas formés, qui arrivent parfois avec plein de préjugés », explique Mehdi Bigaderne. En juin 2025, la France est même condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour contrôle d’identité jugé « discriminatoire ».
En 2023, après la mort de Nahel, Emmanuel Macron dénonçait « l’inexcusable ». En même temps, le président lançait un renforcement sécuritaire jamais vu, dans la continuité de celui instauré en 2005. En vingt ans, la logique de maintien de l’ordre en banlieue, contre ce qui est communément appelé « violence urbaine », s’est durcie avec, depuis 2023, l’utilisation d’unités d’élites comme le Raid ou la BRI. L’usage d’armes dites « non létales » s’est banalisé : grenades de désencerclement, explosives, tirs de LBD 40, gaz lacrymogènes et drones de surveillance. Les doctrines du maintien de l’ordre ont glissé vers encore plus de confrontation directe.
Criminalisation des victimesDepuis 2005, la France a empilé les textes sécuritaires, comme l’article 435-1 du code de la sécurité intérieure, entré en vigueur en 2017. Il encadre l’usage des armes par les forces de l’ordre sous conditions d’« absolue nécessité » et de caractère « strictement proportionné ». Le quatrième alinéa les autorise à faire usage de
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

Après la mort d’El Hacen Diarra, « la France veut copier Trump ou quoi ? »

Aide à mourir : loi validiste ou avancée sociale ? Un débat pour comprendre

Aide à mourir : « J’ai peur qu’on me rembourse mon euthanasie plutôt que mon traitement »







