Le sociologue sans disciples
Dans un « livre-laboratoire », des chercheurs dialoguent avec Robert Castel, dont le parcours s’étend sur près de cinquante ans.
dans l’hebdo N° 1197 Acheter ce numéro
Les juristes appellent cela des « mélanges ». Un certain nombre de chercheurs adressent un hommage à l’un de leurs collègues, souvent en fin de carrière et doté d’un réel prestige intellectuel, en constituant un recueil de travaux dans la lignée de ceux sur lesquels le destinataire a travaillé, voire a été l’un des précurseurs. La caractéristique de cette façon très académique de célébrer un aîné est que ce dernier se contente le plus souvent d’écouter ces communications, rassemblées ensuite en volume, et d’ajouter quelques mots de remerciements, parfois agrémentés de remarques succinctes. Rares sont les longs dialogues qui s’engagent entre lui et ceux qui se placent ainsi dans une position de disciples.
Animés par Claude Martin, directeur de recherches au CNRS et titulaire de la chaire « Lien social et politiques » à l’École des hautes études en santé publique, ces « échanges avec Robert Castel » sont au contraire l’un des éléments les plus passionnants de cet épais recueil qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Autour de l’œuvre et de la trajectoire intellectuelle, critique et politique de celui qui est aujourd’hui considéré à juste titre comme l’un des sociologues français les plus importants de la seconde moitié du XXe et de ce début de XXIe siècle, une vingtaine de ses collègues (dont Gérard Mauger, Numa Murard, Jean-François Laé, Jacques Donzelot, Francis Bailleau, Julia Varela, etc.), inscrits pour la plupart dans un courant « critique » au sein de leur discipline, interrogent l’apport de Robert Castel à celle-ci et, surtout, pour leur propre travail. D’emblée, Claude Martin, dans son introduction sur les « conditions de [cet] échange », prévient toutefois clairement le lecteur : « Ceci n’est pas une biographie intellectuelle. » Et de souligner : « Il ne pouvait être question d’identifier un cercle, une garde rapprochée intellectuelle ; rien de tel n’environne » celui pour qui « le malheur des grands hommes est d’avoir des disciples » !
Conçu avec Robert Castel, le livre se propose donc de « dépasser l’hommage » pour constituer un objet original, un « livre-laboratoire » travaillant la question des « changements et des pensées du changement » en sociologie, qui sont au cœur de son itinéraire personnel et intellectuel de près d’un demi-siècle. Une période où le monde social s’est profondément transformé, passant « du capitalisme industriel à un nouveau régime de capitalisme, plus sauvage, qui joue la concurrence exacerbée au niveau de la planète […] sous l’hégémonie croissante du capital financier international ».
Une transformation qui a vu apparaître « un pessimisme profond à l’égard de l’avenir ». Ce qui a évidemment produit des changements dans les représentations de la société, en particulier « sa lecture par la sociologie ou par les sciences sociales ». Robert Castel y revient en détail dans un texte passionnant en début de volume, sorte de socio-analyse. Or, cette longue période pour son « métier de sociologue » (comme l’écrit Francis Bailleau, dans un beau clin d’œil à Pierre Bourdieu, dont la rencontre, déterminante pour Robert Castel, lui fit abandonner la philosophie) a aussi été celle où, jusqu’à la fin des années 1970, les « orientations critiques occupaient le devant de la scène » et « pouvaient avoir une forte radicalité […] parce qu’elles s’appuyaient sur la conviction que demain pouvait être meilleur qu’aujourd’hui ». Avant de connaître un « retournement de conjoncture »…
Chacun des contributeurs tente donc de « dégager les implications » de tels changements, à la fois du monde social et de la pensée, à partir de l’itinéraire assez solitaire, du sociologue – qui leur répond en fin de chaque partie du livre. Au départ tournée vers la santé mentale, la psychiatrie et la psychanalyse (notamment l’hégémonie lacanienne au cours de la décennie 1970), la sociologie critique de Robert Castel s’est ensuite orientée vers l’étude de la société salariale et de ses « métamorphoses » [^2], avant de s’élargir aux questions familiales, de genre, d’assistance, des toxicomanies ou d’urbanisme.
Mais, outre le fait que cette sociologie adopte toujours pour une large part une perspective historique, étant ainsi « traversée par le paradigme du changement », l’un des points communs de tous ces objets de recherche est qu’ils « s’enracinent dans une même préoccupation : la gestion des marges, des zones sociales “grises”, avec une attention constante à ceux qui sont mal traités dans ces espaces mal (ou trop) définis ». Car, pour Robert Castel, le sociologue « est aussi un citoyen engagé dans la prise en charge des problèmes sociaux », et la sociologie (critique) ne saurait être « un simple exercice académique ».
[^2]: (1) Cf. l’un de ses ouvrages majeurs : les Métamorphoses de la question sociale (Fayard, 1995).
Pour aller plus loin…

L’histoire du conflit israélo-palestinien revisitée
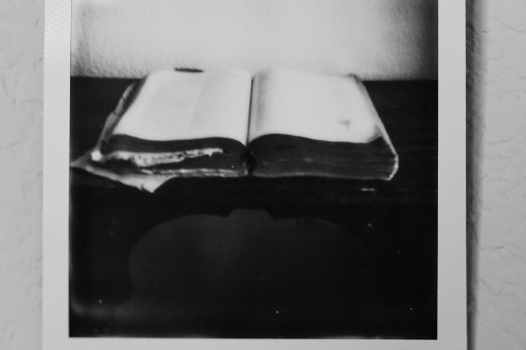
Fragments de mémoire

Rima Hassan : « Je veux garder espoir »








