Victor Collet : « À Exarchia, l’absence de police a facilité des formes d’expérimentation sociales »
Le sociologue raconte dans son nouvel essai, Vivre sans police. Du long été au crépuscule d’Exarchia (Agone), la façon dont ce quartier d’Athènes, au cœur de la contestation durant la crise financière grecque, a vécu une décennie sans police à partir de 2008. Il y explore l’évolution du mouvement anti-autoritaire, entre expérimentations politiques et déchirements internes.
dans l’hebdo N° 1890 Acheter ce numéro

© Maxime Sirvins
Né en 1982, docteur en sociologie et chercheur indépendant, Victor Collet travaille depuis longtemps sur les métamorphoses des villes populaires et les résistances dans les espaces urbains en proie à la gentrification. Originaire de banlieue parisienne, il a publié Nanterre, du bidonville à la cité (2019) puis, installé à Marseille, Du taudis au Airbnb (2023, tous deux chez Agone), il a analysé l’évolution de l’habitat, en particulier après l’effondrement des immeubles insalubres de la rue d’Aubagne. Entre-temps, ses engagements militants et ses enquêtes participatives l’ont mené à s’installer à Exarchia, quartier rebelle athénien adossé à l’université, haut lieu des luttes contre la crise financière.
Dans quel contexte la police s’est-elle retirée du quartier d’Exarchia, à Athènes, en 2008 ?
Le 6 décembre 2008, le jeune Alexis Grigoropoulos est tué par la police. S’ensuit une importante vague de révoltes. En deux nuits, une quarantaine de commissariats sont attaqués partout en Grèce. Toute une partie de la population soutient les manifestations. À Exarchia, il y a des émeutes toutes les nuits ou presque pendant un mois. L’atmosphère contestataire de ce quartier ne diffère pas d’autres endroits, à la seule différence qu’il abrite l’École polytechnique, un bastion intangible de politisation et du mouvement anarchiste, puissant dans le pays.
Ce meurtre agit aussi comme un retour de traumatismes liés à l’histoire de la dictature dans le pays. Car c’est à l’École polytechnique qu’a commencé l’insurrection contre la dictature des colonels, le 17 novembre 1973, écrasée dans le sang. Les chars sont entrés dans l’école, 80 personnes ont été tuées. Pour cette raison, l’université devient un sanctuaire de la vie politique en Grèce après la chute de la dictature en 1974. En 2008, cette révolte inattendue fait peur au pouvoir. En raison du rapport de force établi, le gouvernement maintient la police à distance. Cela durera une décennie.
Vivre sans police à Exarchia à partir de 2008, c’est par exemple lutter contre un projet immobilier qui doit s’implanter sur un vieux parking et en faire le seul autre espace de verdure, avec la colline de Streffi, de ce quartier hyperdense. Il faut s’imaginer un quartier tout petit mais très central : c’est comme si on avait une ZAD urbaine au cœur de la capitale, et en même temps un lieu où une intrusion risque de mettre le feu aux poudres.
Comment ce quartier répond-il à la crise financière de 2008 et à l’austérité qui s’ensuit ?
2008 est à la fois un moment fédérateur de révolte contre la police et ses meurtres, et contre ce continuum dictatorial refoulé, doublé d’une histoire torturée entre la Grèce et l’Union européenne (UE). Quelques mois à peine après le meurtre d’Alexis Grigoropoulos, les Grecs souffrent : la troïka, à savoir l’UE, le FMI et la Banque centrale européenne (BCE), impose des coupes budgétaires dans leur vie quotidienne, dans le régime des retraites et l’assurance maladie. À cette époque, un tiers de la population est exclu de toute couverture maladie. La Grèce vend toute une partie de son patrimoine national au plus offrant – c’est la vente aux enchères du pays.
Exarchia répondra à sa manière en offrant une base arrière lors des grosses grèves et manifestations qui démarrent au printemps 2010. À ce moment-là, la dégradation de la note du pays par les agences de notation entraîne un risque de banqueroute. La Grèce se retrouve dans l’incapacité d’emprunter sur les marchés, donc à la merci de ses créanciers. La BCE refuse de débourser le moindre sou en solidarité avec la Grèce et met à genoux le gouvernement, contraint, pour obtenir les prêts de l’UE et rembourser sa dette, d’accepter la destruction du Code du travail et des acquis sociaux.
Le 5 mai 2010, une manifestation vire à l’émeute devant le Parlement, et trois employés d’une banque qui se trouvent sur le trajet de la manifestation mourront brûlés vif après un incendie provoqué par un cocktail Molotov. L’enquête montrera dix ans plus tard que le patron les avait forcés à rester travailler sur place et avait fait fermer les portes de sécurité.
L’absence de police facilite nécessairement le développement de formes d’expérimentation sociales comme les centres de soins autogérés ou les cantines populaires.
Ce moment crée une énorme scission dans le mouvement anarchiste, pourtant aux avant-postes de la contestation. Certains questionnent le compagnonnage avec ces jeunes dits « encagoulés » et « toute une jeunesse sauvage » qui fraye avec le mouvement anarchiste. D’autres se demandent jusqu’où
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

Au Sénat, la tentation d’une superpolice municipale

« La hausse des droits de douane se répercute sur les ménages américains les plus modestes »
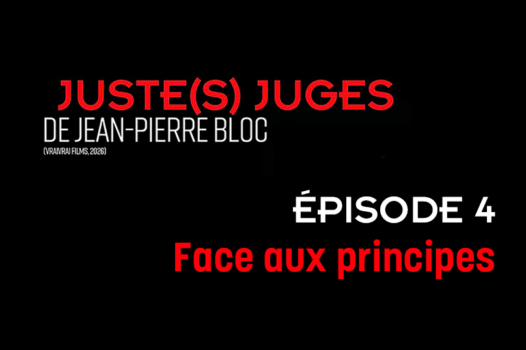
Juste(s) juges – Épisode 4







