PMA : « La loi est en retard »
La juriste Laurence Brunet détaille les enjeux de la loi en préparation : extension de la PMA, dons d’ovocytes…
dans l’hebdo N° 1525 Acheter ce numéro
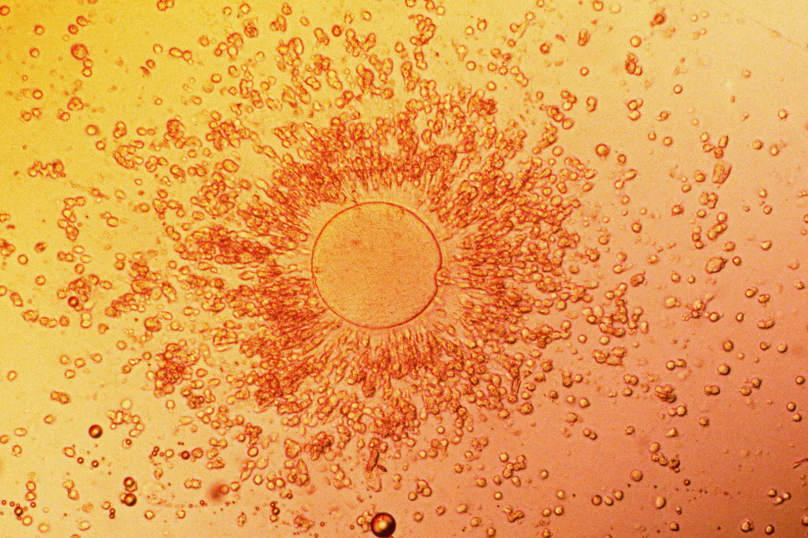
L’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules sera inscrite dans la prochaine loi de bioéthique, assure la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. « Tous les feux sont au vert du côté du Conseil consultatif national d’éthique, du Conseil d’État et des parlementaires », a-t-elle affirmé le 21 octobre sur RTL.
Cette position anticipe les débats parlementaires qui vont se tenir lors des révisions de la loi de bioéthique, début 2019. Si le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a effectivement rendu un avis favorable à l’extension de la PMA le 25 septembre (avis n° 129), les parlementaires semblent encore mitigés. Derrière la PMA, sujet le plus visible des révisions des lois de bioéthique, c’est une évolution de la conception de la filiation qui entre en discussion cet hiver. Entretien avec Laurence Brunet, juriste, spécialiste en droit de la famille.
L’avis 129 du CCNE marque des avancées sur l’accès aux origines. Comment les comprenez-vous ?
Laurence Brunet : Cet avis est novateur mais il est difficile d’y voir clair sur la manière de procéder. Le CCNE estime qu’il faut lever l’anonymat sur les dons futurs, mais dans le respect du donneur. Faut-il comprendre qu’on ne prendra plus comme donneurs que des personnes d’accord pour révéler leur nom, ou que l’on avancera vers un système semi-rétroactif, où les enfants pourraient retrouver leur donneur à leur majorité, comme pour l’accouchement sous X ? On ne peut pas, en tout cas, continuer avec un système où les donneurs auraient l’espoir de n’être pas « retrouvés », alors que les big datas permettent aujourd’hui de croiser les données génétiques de leur « descendance » en dehors de tout cadre juridique. Les gens envoient un échantillon de salive à partir duquel leur génome entier est établi puis recoupé via des algorithmes. À partir du moment où les génomes sont dans les bases, on peut les utiliser.
Quels risques pour la protection des données génétiques ?
On peut demander des tests génétiques pour 100 euros environ. En contrepartie, on partage son génome. Les enfants nés de PMA envoient donc leur génome aux cinq grandes bases de données telles que 23andMe ou Ancestry. Cela signifie qu’on peut vous identifier même si vous n’avez pas fait la démarche de faire répertorier votre génome, mais que des apparentés l’ont fait. Des revues scientifiques comme Human Reproduction ont lancé l’alerte en 2016. Mais que faire quand des personnes ont accepté que leurs données soient commercialisées ?
Comment les réflexions éthiques et juridiques évoluent-elles vis-à-vis de l’extension de la PMA ?
Le CCNE avait déjà donné son feu vert en juin 2017. Mais la loi est en retard : depuis 2013, les familles homoparentales sont reconnues par le droit français dans le cas de PMA réalisées à l’étranger. L’enfant a deux mères : celle qui l’a porté et celle qui l’« adopte ». Les juges ont fait un travail que les législateurs n’avaient pas réalisé. Des livrets de famille peuvent indiquer deux mères, et même deux pères. L’extension de la PMA permettrait notamment aux femmes de ne pas devoir se rendre en Belgique ou en Espagne, possibilité réservée à celles qui en ont les moyens. Et ainsi de ne pas cantonner la deuxième mère au rôle d’adoptante. Dans un couple hétérosexuel où le père est stérile, on ne lui demande pas d’adopter l’enfant né de sa femme et d’un don de sperme. À partir du moment où un couple hétérosexuel stérile a droit à un projet parental, pourquoi refuser la présomption de parenté aux autres couples mariés ? L’adoption hiérarchise les filiations : la femme qui accouche est la mère, la deuxième mère doit passer devant un juge. Une procédure longue, coûteuse et au cours de laquelle le couple peut se séparer. La deuxième mère peut donc se retrouver chassée de la vie de l’enfant.
Pourquoi y a-t-il moins de réticences pour les femmes seules ?
Les femmes seules qui demandent une PMA ont en général passé 40 ans, une situation stable… Les « mamans solos » auditionnées par le CCNE expliquaient avoir beaucoup travaillé sans trouver l’âme sœur. Mais elles ne remettaient pas en cause la conjugalité, notamment hétérosexuelle.
Comment évolue la perception de l’infertilité ?
Dans la loi de 1994, pour avoir accès à la PMA, il fallait être un couple constitué d’un homme et d’une femme en âge de procréer. La question de l’âge a changé : si une femme n’est pas ménopausée à 40 ans, sa fertilité a chuté depuis ses 35 ans, mais elle peut porter un enfant jusqu’à 45 ans. Les femmes se sont émancipées, ont fait des études, travaillent, et l’âge moyen du premier enfant est passé en une génération de 23 à 28,5 ans. En revanche, l’horloge biologique n’a pas changé. La PMA a donc été sollicitée pour des raisons sociétales, c’est-à-dire une infertilité physiologique, et non pathologique. Sans compter que les couples se renouvellent, les familles se recomposent et des femmes de 42, 43 ans arrivent dans les services de PMA avec un compagnon plus jeune et sans enfant.
D’où la revendication autour de l’autoconservation d’ovocytes ?
L’autoconservation d’ovocytes me paraît la grande révolution du XXIe siècle en matière de procréation. Les femmes veulent répondre à la longueur des études, aux carrières prenantes, à la procrastination de la conjugalité et de la parentalité… Ce qui ressort des études sociologiques, c’est qu’elles ne trouvent pas d’homme pour un projet éducatif « dans les temps ». Le raisonnement est le suivant : à 25-28 ans, je conserve des ovocytes jeunes que je pourrai utiliser vers 35-40 ans. Cette démarche se rencontre dans des milieux plutôt urbains, plutôt privilégiés, même si la PMA s’est démocratisée. Et on sent aussi monter l’angoisse d’être de vieilles mères : ces femmes veulent conserver leurs ovocytes pour gagner quelques années. Des « années cruciales ».
Pourquoi parle-t-on moins du don d’ovocytes que du don de sperme ?
On devrait, car le don d’ovocytes ne fonctionne pas bien. L’an dernier, il a dû y avoir 250 donneurs de gamètes et environ 500 donneuses d’ovocytes. Mais, sur un don, on récolte quelques ovocytes contre des millions de spermatozoïdes. Il manque entre 700 et 900 donneuses en France. La pénurie est devenue aiguë. Les délais sont de trois ans en moyenne. Du coup, les Françaises partent massivement chercher un don d’ovocytes à l’étranger pour ne pas dépasser 40 ans.
Des réticences s’expriment vis-à-vis des Cecos, les banques de gamètes. Pourquoi ?
Je comprends qu’il existe des réticences face au « matching », « l’assortiment » des donneurs avec les receveurs. Les Cecos travaillent dans l’opacité et entretiennent le mimétisme : des enfants blonds pour des parents blonds, par exemple, comme pour sauver les apparences. On pourrait très bien décider de laisser faire la « loterie génétique », que les enfants issus d’une PMA ne ressembleront pas forcément à leurs parents, que la cellule familiale n’imite pas nécessairement la cellule naturelle. Cela ouvrirait la perception de la parentalité.
L’égalité des droits va-t-elle s’étendre des couples de femmes aux couples d’hommes ?
Les femmes peuvent porter des enfants, les hommes non. Cette différence induit des droits différents. Mais la procréation par gestation pour autrui (GPA) est indirectement déjà admise en France, où les enfants issus d’une GPA à l’étranger sont reconnus juridiquement. Ce qui signifie que les couples qui ont de l’argent peuvent partir à l’étranger réaliser une GPA et pas les autres.
L’opposition à la GPA n’a pas surgi vis-à-vis des homosexuels, mais lorsque des couples hétérosexuels ont commencé à y avoir recours à l’étranger, au début des années 2000. L’opprobre est bien lié à la peur de la marchandisation des corps et de l’instrumentalisation de la porteuse. Pour ma part, j’ai été retournée par les familles que j’ai rencontrées. En Israël, aux États-Unis, au Royaume-Uni, les systèmes diffèrent, mais la pratique est accompagnée. Pour que la GPA ne soit pas un système horrible, il faut que la porteuse ait une place et que la pratique soit encadrée, humaine.
Pourquoi évoquez-vous une étape révolutionnaire dans la manière de faire famille ?
On est face à une révolution… qui est en fait une évolution logique : importance de la science, valorisation de la parenté, émancipation des femmes et indifférenciation dans les rôles parentaux. On parle désormais de deux parents devant assumer de la même manière leurs droits et leurs obligations d’éducation et d’entretien des enfants. C’est un mouvement vers plus d’égalité.
Laurence Brunet Juriste, spécialiste en droit de la famille.
Pour aller plus loin…

Les athlètes lèvent-ils toujours le poing ?

Foot à Nîmes : carton plein pour les joueurs sourds

« La brutalité olympique dans le 93 : un vrai poison pour la démocratie »








